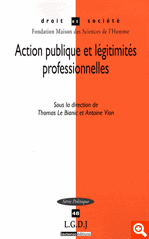Navigation
Recherche
Livres et revues
Cette rubrique réunit des ouvrages qui ont attiré notre attention et pour lesquels nous vous proposons nos commentaires ou une recension.
Vingt ans de politique portuaire à Bruxelles (1993 - 2012) - II. Contrats de gestion 1994-1999 et 2002-2007

Geneviève Origer, Courrier hebdomadaire du CRISP n° 2231-2232, 99 p., 2014
Créé par l’ordonnance du 3 décembre 1992, le Port de Bruxelles fonctionne depuis le 1er juin 1993. Avec la STIB, il est l’un des premiers organismes para-régionaux à avoir conclu un contrat de gestion avec la Région. Aujourd’hui, il gère le second port intérieur belge.
À l’occasion des vingt ans du Port de Bruxelles, le Courrier hebdomadaire étudie les contrats de gestion successifs auxquels a été soumise la société régionale.
L’objectif est d’éclairer les décisions politiques qui ont présidé à l’évolution des installations, du foncier et du fonctionnement du Port, en examinant les positions des différents acteurs régionaux et les arbitrages rendus. Il s’agit également d’analyser la manière dont les contrats de gestion ont été mis en œuvre en fonction des enjeux régionaux, et la mesure dans laquelle ils ont porté le rôle du Port dans l’économie, l’emploi et la mobilité. Cette étude est réalisée par Geneviève Origer, ancienne directrice en charge du développement du Port.
Compte-rendu. Innovation politique 2012

Lien vers le site de la Fondation pour l’innovation politique
L’ouvrage collectif Innovation politique 2012 regroupe les principaux travaux réalisés par le Fondation pour l’innovation politique entre septembre 2010 et octobre 2011.
Cette fondation se définit comme un think thank « libéral, progressiste et européen ».
Deux contributions, qui ne sont pas les plus signifiantes de l’ouvrage consacré à l’innovation politique (dans les domaines de la dette publique, de la croissance, du retour du tirage au sort en politique, etc..) ont suscité notre intérêt. Il s’agit de l’article Valoriser les monuments historiques de nouvelles stratégies par Wladimir Mitrofanoff (ancien président de l’Académie d’architecture) et Christiane Schmuckle-Mollard (membre du conseil de l’Académie d’Architecture. Ce texte attire l’attention sur l’apparition en France d’un instrument juridique novateur pour la valorisation des propriétés de l’Etat, le bail emphytéotique de valorisation (BEA de valorisation). Ce nouveau dispositif permet à l’Etat de contrôler la conformité de l’activité du locataire par rapport au bail et de lui accorder en contrepartie des droits réels, nécessaires à l’obtention de crédits bancaires indispensables à la conduite d’opération de restauration de grande ampleur. Outre l’aspect du rayonnement de la France dans le monde, l’enjeu est aussi de taille sur le plan de l’emploi. En effet, les 3.396 monuments historiques français créent ou induisent 500.000 emplois.
Le second texte rédigé dans un style fonctionnel par Thierry Weibel, directeur auprès du Groupe Voirin Consultants – ATELYA, décrit et analyse l’administration 2.0.
L’auteur se demande si « l’alignement stratégique » sur la politique des restrictions budgétaires est pertinent dans le domaine de l’administration 2.0 ? Poser la question équivaut à y répondre. Selon le contributeur, un million d’euros investis dans des travaux de voirie ne dégagent pas la même valeur ajoutée qu’un million d’euros investis dans l’administration 2.0.
En effet, les dix dernières années ont vu l’innovation et les nouveaux apprentissages de l’informatique quitter l’entreprise et rejoindre la société civile : de nouveaux modèles de communication (MSN, Skype, Wikipedia..), de nouveaux modèles de relation (Facebook, Twitter, LinkedIn), de nouveaux modèles économiques (Amazon, Google), de nouveaux modèles techniques (cloud computing, consommation de l’informatique par abonnement).
Le concept d’administration numérique est une réponse signifiante et opérationnelle aux problématiques posées dont celle du more services for less money.
Selon l’auteur, le service numérique implique une « stratégie tetris » qui tire son nom du jeu vidéo Tetris. Dans ce jeu, le joueur dit décider rapidement de la meilleure façon de placer différentes pièces défilant à une vitesse toujours croissante. Pertinence du choix de placement et la vitesse de prise de décision sont donc deux facteurs à prendre en compte.
Selon cette stratégie, il serait parfois plus rentable de choisir une solution simplement « assez correcte » plutôt que de rechercher la meilleure solution en y consacrant beaucoup d’énergie et de temps.
Les algorithmes employés en intelligence artificielle consacrent ce principe de sélection.
Pour Thierry Weibel, l’administration 2.0 est hautement collaborative et poreuse aux influences du secteur privé et des particuliers. Comme le secteur public est historiquement dans l’unilatéralité avec les usagers et son éco-système, il s’avère nécessaire d’aménager le management public pour le rendre compatible avec l’administration électronique.
A ce titre, les portails collaboratifs apportent des solutions pertinentes. L’e-room ou espace collaboratif est destiné à l’équipe projet qui peut, de la sorte, travailler en mode asynchrone.
D’après le contributeur, les usagers du service public devront accepter « …l’imperfection de l’expérimentation, voire de l’abandon de certains services. L’image d’une administration faiblement adaptable mais fiable et constante se trouvera transformée en territoire public flexible, à géométrie variable, réactif et parfois pris en défaut ».
L’administration 2.0 pourrait pense-t-il devenir dans les cinq années à venir, la nouvelle offre de services publics adaptée aux contraintes et aux attentes. Cette nouvelle offre conçue et portée en partenariat avec le secteur privé, peut être assimilée à une nouvelle politique de grands travaux.
Cet article résume bien les enjeux notamment en termes de productivité. Il illustre aussi les tensions structurelles entre la qualité de la prestation administrative et l’accélération continue de sa délivrance.
On regrettera néanmoins que la contribution n’aborde que sommairement, la problématique fondamentale de la gestion des ressources humaines dans ce nouveau contexte.
Alexandre Piraux
Recension. Les perdants de la modernisation

Depuis la libéralisation de grands secteurs économiques comme les services postaux, les chemins de fer ou encore l’énergie, les entreprises publiques sont engagées dans un processus permanent de modernisation et d’adaptation au marché. Des changements structurels ont été nécessaires pour mettre l’efficacité et la rentabilité au coeur des machines et des préoccupations de ses travailleurs. La réduction des coûts a marqué de son empreinte la gestion des ressources humaines, le développement de l’informatique et de la communication. Chez Belgacom ou chez Bpost, le nouvel organigramme est à présent en forme de pyramide inversée, plaçant à sa tête le client et à sa base le CEO de l’entreprise. [1] Ces bouleversements ont eu lieu, soit de façon relativement progressive, par exemple chez Belgacom, soit à marche forcée et dans la douleur, comme chez Bpost. On se souvient de la fermeture de nombreux bureaux de poste et de la mise en place du programme Georoute I, II et III.
Dans un article paru dans le n°17 de Pyramides (« Les travailleurs statutaires peu qualifiés dans la modernisation des entreprises publiques »), John Cultiaux relevait déjà , à travers le point de vue de travailleurs, les contradictions des entreprises publiques écartelées entre tradition de service publique et objectifs économiques. Son livre, Les perdants de la modernisation, accorde une large place aux récits d’expériences singulières et aux analyses produites par les travailleurs, regroupées au sein de deux grandes thématiques : l’isolement et la résistance.
Personne ne remet en question la modernité en soi. La modernité, et a fortiori l’hypermodernité, a ses perdants et ses gagnants. Les gagnants, ceux qui disposent des attributs positifs de l’individualité mises en valeur par les nouvelles règles de management (sens des responsabilités, capacité d’indépendance et d’autonomie), ce sont « les travailleurs du service public de demain ». La gestion des ressources humaines veille à développer leurs potentialités individuelles et leur désir de se réaliser à travers le travail. Quant aux perdants, principalement des travailleurs statutaires peu qualifiés, ils sont jugés peu performants et disqualifiés par leurs supérieurs. Ce sont des « individus par défaut », des incasables qui restent en fonction au seul bénéfice de leur statut qui leur assure la sécurité de l’emploi mais leur retire, comme tend à le démontrer l’ouvrage de John Cultiaux, le droit à la parole. En effet, ces travailleurs restent considérés comme des anciens, à jamais associés aux erreurs du passé. C’est pour cela que leur expérience négative du changement est considérée comme une plainte nostalgique et non comme une critique utile. Dès lors, leur souffrance a été justifiée par ce que John Cultiaux appelle un faux concept : leur résistance au changement. On pourrait dire que c’est sur ce point que la modernité tombe dans les erreurs de l’hypermodernité, telle qu’elle est définie par Gilles Lipovetsky, « une modernité qui ne rencontre plus de résistances organisationnelles et idéologiques de fond ». [2] Or dans Les perdants de la modernisation, l’auteur dit : « Ce ne sont pas tant les individus qui résistent au changement mais bien le changement (social, organisationnel et personnel) qui résiste à certains individus au risque de les exclure ». Il précise encore : « La résistance n’est pas une prédisposition psychologique mais la conséquence d’un manque de reconnaissance et d’une insécurité existentielle que les individus éprouvent parfois jusqu’au déni de leur propre existence ».
Ghislaine, réaffectée dans un call center, réprimandée par son chef de service pour avoir passé trop de temps à expliquer la résiliation d’un abonnement téléphonique à une cliente âgée ; Pierre, ancien
technicien, affecté au service dispatching, confronté aux incompétences des techniciens envoyés sur le terrain après une formation bidon, les témoignages indiquent une faille importante dans le système : la perte du sens et de la qualité du travail. La mission de service public à laquelle ces travailleurs étaient attachés ne se retrouve plus dans les tâches qui leur sont assignées. La satisfaction du client ne coule pas de source. « Dans le domaine postal, le client n’est pas celui qui reçoit le courrier mais celui qui paie pour l’envoyer, rappelle Stéphane Daussaint, permanent CSC-Transcom. Les gagnants de la libéralisation sont les entreprises qui émettent du courrier en grand nombre et qui bénéficient de tarifs préférentiels. Les autres - citoyens, indépendants, PME - paient le prix fort. On est passé d’une logique de service public à une logique purement commerciale. Le citoyen passant du statut d’usager à celui de consommateur ». [3]
Pour les travailleurs que John Cultiaux a rencontrés, l’organisation du travail empêche toute solidarité. Afin d’accroître la rentabilité, les nouveaux dispositifs de travail favorisent l’autonomisation des travailleurs (motorisation, etc..). Dans certains cas, la gestion du personnel fonctionne à flux tendu et le recours aux intérimaires est fréquent. Dans les call centers, les postes sont occupés par des étudiants, des « premiers emplois », des travailleurs transitoires. Cette diversification des statuts et des conditions de travail a contribué à la fragmentation du collectif. De plus, les déficits de personnel encouragent l’interchangeabilité des postes. John Cultiaux écrit : « Le collectif de travail est devenu un collectif individualisé façonné par des normes implicites de comportements adéquates aux intérêts de chacun … La désolidarisation, l’attitude de retrait prend la forme d’un report systématique de la pression et des ajustements sur le niveau inférieur pour se concentrer sur son propre travail ». Le coach ou le chef de service est perçu comme un relais des instructions de ses supérieurs dont le seul souci est de satisfaire sa hiérarchie. Déconnectés du travail de terrain, ils sont incapables de « descendre dans le trou », comme l’expriment les travailleurs interrogés. Certains peuvent également être perçus comme des traîtres, dès lors qu’ils ont choisi leur carrière au détriment du collectif. Nicole Aubert [4] énumère les conséquences de cette adhésion négative : perte de la mobilisation, dégradation des relations sociales et personnelles, souffrance psychique et dévalorisation.
La plupart des perdants dénoncent la perte d’un lien, d’un travail d’équipe et témoignent d’un sentiment d’isolement éprouvé au quotidien. Certaines réorganisations détruisent les dynamiques collectives et par conséquent la performance. Sans dynamique collective, le travail n’a plus de sens.
Pour conclure, John Cultiaux note : « Il ne s’agit pas d’opposer seulement une « vision traditionnelle » du service public à une vision « marchande » des entreprises publiques. Les individus portent aussi dans leurs analyses une critique en termes d’efficacité (critique industrielle). La demande de reconnaissance des individus porte donc sur la mise en évidence de ce déni d’évaluation dont ils font l’objet ». C’est beaucoup à cela que tient l’intérêt de l’ouvrage : en donnant la parole aux travailleurs souvent écartés des évaluations, nous avons accès à une critique de la modernisation qui soulève des questions très pratiques. Leur demande de reconnaissance est intimement liée à leur désir de faire évoluer leur fonction dans un souci d’efficacité. A l’heure où les administrations déploient des efforts pour déceler les talents parmi leurs travailleurs, il est utile de mesurer les qualités de ceux qui occupent les plus bas échelons de la hiérarchie, à leur juste valeur. C’est pour cette raison que « les perdants de la modernisation » trouve sa place dans la rubrique de la guerre des talents.
Florence Daury
Recension. Les aspects bruxellois de l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011

Un des dernières livraisons du Courrier hebdomadaire du CRISP est consacrée au copieux volet bruxellois de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’Etat. Il est rédigé par Jean-Paul Nassaux, membre du Comité de rédaction de la revue Pyramides qui est également un spécialiste reconnu et apprécié des problèmes institutionnels bruxellois.
L’Accord institutionnel du 11 octobre 2011 inclut trois accords légèrement antérieurs : celui sur la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, celui sur la simplification intra bruxelloise, et l’accord sur le refinancement de Bruxelles et la réforme de la loi spéciale de financement. La simplification intra bruxelloise et la scission de l’arrondissement satisfont la demande flamande tandis que le refinancement substantiel répond aux desiderata francophones.
L’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’Etat a, selon l’auteur, consolidé le statut de Bruxelles. Ainsi l’octroi de l’autonomie constitutive a-t-il une portée réelle, même si les ordonnances bruxelloises ne sont toujours pas mises sur le même pied que les décrets wallons et flamands.
Le recours prévu par l’accord institutionnel à la Commission communautaire commune (COCOM), institution bi-communautaire composée exclusivement d’élus bruxellois, permet d’éviter que les citoyens bruxellois ne doivent opter pour une des deux grandes communautés dans le cadre des compétences communautaires transférées et de mettre en place des régimes différents selon l’appartenance linguistique du bénéficiaire. Le piège de la sous-nationalité qui aurait divisé les citoyens bruxellois a donc été déjoué. L’idée de Bruxelles comme capitale commune cogérée par les deux grandes communautés a été complètement écartée dans l’accord au grand dam de la N-VA.
Un élément essentiel de l’accord institutionnel réside, comme on le sait, dans le refinancement substantiel des institutions bruxelloises (486 millions d’euros annuels à l’horizon 2015) ce qui est une réponse concrète au sous-financement structurel de Bruxelles.
L’accord sur la simplification intra bruxelloise, intégrée à l’accord général, a été élaboré par les Bruxellois eux-mêmes. Il ne s’agit que d’une étape d’un processus et non d’un aboutissement.
De nouveaux fragments de compétences sont transférées à la Région de Bruxelles-Capitale : l’emploi (le contrôle de la disponibilité des chômeurs et sanctions, l’activation des allocations de chômage, les réductions ciblées des cotisations sociales vers un groupe déterminé de demandeurs d’emploi,…), la politique économique et industrielle, la mobilité et la sécurité routière (la détermination des limites de vitesse sur le voie publique, la réglementation en matière de placement de la signalisation, les compétences de l’IBSR,..), l’Energie et l’Environnement (régionalisation des tarifs de distribution sauf l’électricité pour les réseaux de transport, ...) l’urbanisme, le logement et l’aménagement du territoire (les baux d’habitation, les baux commerciaux, la procédure d’expropriation, le transfert des comités d’acquisition, etc …) la Justice (la définition de la nature des mesures pouvant être prises à l’égard de mineurs ayant commis un fait d’infraction) et aussi d’autres compétences. Ainsi dans le domaine de la fonction publique, la Région (tout comme les autres entités fédérées) se voit attribuer pleine compétence pour fixer le statut administratif et pécuniaire de son personnel, l’arrêté royal fixant les principes généraux du statut communs aux diverses entités fédérale et fédérées qui servait de socle commun et de verrou protecteur pour les agents, étant prochainement abrogé. Enfin, un nouveau droit est accordé, la Région de Bruxelles-Capitale reçoit la possibilité d’organiser des consultations populaires sur les matières d’intérêt régional.
Dans le cadre de la simplification intra bruxelloise, les Bruxellois ont selon Jean-Paul Nassaux « engrangé des succès significatifs sur le plan du transfert de certaines compétences à leur Région. D’abord, en matière de sécurité, ….ensuite avancée qui apparaissait plus problématique à obtenir dans des matières communautaires : infrastructures sportives, formation professionnelle, tourisme, et d’une façon plus réduite, culture. » Cela même s’il n’est pas porté atteinte aux compétences des Communautés dans ces matières transférées. Il y a donc eu compromis entre les régionalistes et les communautaristes. Si la Région est renforcée dans ses politiques urbaines : la sécurité, les infrastructures sportives, la formation professionnelle, et le tourisme, c’est parallèlement aux Communautés et non à leur détriment.
En ce qui concerne les compétences transférées au sein de la Commission communautaire commune, il s’agit des soins de santé, de l’aide aux personnes (dont les allocations familiales et la jeunesse), et des personnes âgées. Il reste néanmoins, en matière de santé, des points à préciser concernant la régime mono-communautaire ou bicommunautaire des compétences transférées.
Notons qu’à Bruxelles, en termes d’homogénéisation de la politique hospitalière, il y aura quatre régimes hospitaliers : celui de la Communauté française pour les hôpitaux universitaires francophones, celui de la Commission communautaire française (très résiduaire) pour les autres hôpitaux francophones, celui de la Commission communautaire commune pour les hôpitaux bilingues, et celui de la Commission flamande pour les hôpitaux néerlandophones.
Jean-Paul Nassaux réussit à nouveau, le tour de force exemplaire d’expliquer en termes clairs mais de façon précise et minutieusement structurée, la nouvelle mécanique institutionnelle et ses enjeux. Cette dernière semble encore plus complexe à mettre en oeuvre que les précédents montages institutionnels et ce malgré la volonté politique de simplification intra bruxelloise.
Par ailleurs, on ne connait toujours pas au moment d’écrire ces lignes début juin 2012, l’ampleur des ressources financières et des mouvements de fonctionnaires qui accompagneront les transferts de compétence. Ainsi, faut-il parler en termes de dizaines ou de centaines d’unités transférées ?
Manifestement, l’Accord institutionnel dans ses aspects bruxellois, n’est qu’une étape intermédiaire d’un processus qui restera âprement discuté si ce n’est contesté par ceux qui souhaitent toujours que les deux grandes Communautés cogèrent Bruxelles.
Selon nous, l’Accord qui renforce la fragmentation de l’offre administrative déjà passablement dispersée, introduit la question de la performance institutionnelle future de la Région de Bruxelles-Capitale. Le foisonnement institutionnel induit par les accords, traduit certes un attachement aux valeurs démocratiques et à l’autonomie bruxelloise mais a aussi un prix. Si on n’y prend garde, il risque de faire de Bruxelles un endroit où le quotidien sera des plus complexes à vivre. Un énorme effort d’articulation des politiques publiques et de coordination des structures administratives les appliquant devra nécessairement être initié et mené à bon terme. Cela prendra nécessairement beaucoup de temps.
Alexandre Piraux
Recension. Le nouveau mouvement bruxellois

Ce Courrier hebdomadaire du CRISP paru début juillet et rédigé par Jean-Paul Nassaux, membre du CERAP a pour objet officiel « Le nouveau mouvement bruxellois ». En réalité son véritable objet traite de la démocratie et des pratiques démocratiques.
Manifesto (2003), Aula Magna (2005) et BruXsel forum (2005) qui sont des groupes ou des associations citoyennes vont unir leurs forces pour constituer ce que Jean-Paul Nassaux appelle le nouveau mouvement bruxellois.
La constitution d’une plate-forme de la société civile où les trois associations sont rejointes par les interlocuteurs sociaux, les associations environnementales et les réseaux culturels, fait émerger un projet commun dans le quel apparaissent plusieurs des idées fortes du mouvement bruxellois : multilinguisme des services, communauté urbaine pour des domaines qualifiés de « transrégionaux » tels que l’aménagement du territoire, la mobilité, le réexamen de la collaboration entre les communes et la région, liste bilingue, carte d’identité bilingue pour ceux qui le souhaitent.
Trois universités bruxelloises (FUSL, ULB, VUB) sont également mobilisées pour rejoindre et éclairer la société civile. Fin 2008, début 2009 seront ainsi organisés des Etats généraux de Bruxelles.
Entre-temps un nouveau parti, Pro Bruxsel arrive sur la scène politique où il essaie de se faire une place au soleil. Il obtiendra 1,8 % des suffrages aux élections régionales soit plus que Groen ! et PTB+, et 1,3% aux élections fédérales du 13 juin 2010. L’implantation de Pro Bruxsel est meilleure du côté néerlandophone.
Dans les conclusions des Etats généraux présentées le 25 avril 2009, les auteurs en grande partie universitaires veulent « réussir la ville en réduisant la fracture sociale ». Pour ce faire, ils préconisent un renforcement des équipements collectifs et des services au public. Le texte entend aussi associer les usagers des deux autres régions et de la fonction européenne à un pacte métropolitain de développement et de solidarité (pages 47-48). Jean-Paul Nassaux remarque à ce sujet qu’une telle attention portée au service public n’est pas habituelle dans les textes du nouveau mouvement bruxellois, sauf sous l’angle linguistique. « Elle est vraisemblablement due aux partenaires syndicaux. » selon l’auteur.
Le Plan culturel pour Bruxelles qui se situe dans la logique des Etats généraux, comporte de nombreuses propositions :
![]() l’établissement de zones prioritaires en matière de développement culturel qui devraient être l’axe du canal, le quartier européen, le Cinquantenaire ;
l’établissement de zones prioritaires en matière de développement culturel qui devraient être l’axe du canal, le quartier européen, le Cinquantenaire ;
![]() la possibilité pour la région d’imposer un cahier des charges urbanistique et architectural à tout nouveau projet d’infrastructure culturelle d’envergure, quel que soit le pouvoir subsidiant ;
la possibilité pour la région d’imposer un cahier des charges urbanistique et architectural à tout nouveau projet d’infrastructure culturelle d’envergure, quel que soit le pouvoir subsidiant ;
![]() l’octroi de compétences culturelles à la Région de Bruxelles-Capitale ;
l’octroi de compétences culturelles à la Région de Bruxelles-Capitale ;
![]() la mise en place d’une cellule de coordination pour les affaires culturelles par les deux communautés, la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande.
la mise en place d’une cellule de coordination pour les affaires culturelles par les deux communautés, la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande.
Le Plan culturel pour Bruxelles qui est le fruit de la coopération entre opérateurs culturels francophones et néerlandophones à Bruxelles a démontré la possibilité d’une bonne collaboration intercommunautaire et intra-bruxelloise.
Le 21 juillet 2010, les Etats généraux de Bruxelles se verront décerner à Gand, le prix de la démocratie 2010.
Selon Eric Corijn (VUB), un des initiateurs de la plate-forme, les Etats généraux « ont percolé » dans la société civile bruxelloise et influencé certains passages de la déclaration gouvernementale bruxelloise (2009).
Tous ces mouvements ont le mérite d’ouvrir le débat institutionnel à un public plus large en stimulant et suscitant l’ethos démocratique par la discussion et l’argumentation et ce même si « La démarche de la plate-forme civile était chargée d’une certaine ambiguïté, la frontière entre réflexion collective et engagement dans un projet de ville n’étant pas clairement fixée ».
Il est aussi sans doute vrai que l’ensemble des participants comptant au reste peu de « nouveaux Belges » ne partagent pas nécessairement tous les mêmes convictions avec le même degré d’intensité ; on songe ici notamment à l’approche de la métropolitisation [1] favorisant l’angle purement socio-économique des relations entre Bruxelles et son hinterland sans aborder la question des droits de la population francophone, à la régionalisation de l’enseignement ou à la suppression des communautés.
Il ressort aussi de ce numéro rigoureux, précis et passionnant pour tous ceux qui ont de l’intérêt pour la constitution de réseaux, associations et mécanismes démocratiques, que les projets mis en avant nécessiteront paradoxalement des pas supplémentaires dans la complexité institutionnelle et administrative.
Un des futurs enjeux est ainsi celui de l’articulation entre les procédures formalisées traditionnelles de concertation et les nouvelles consultations (débats publics, assises, Etats généraux) souvent plus ambiguës ou floues. A ce dernier égard, un nouveau parti comme Pro BruXsel s’essaie au rôle de traducteur ou de passeur de nouvelles idées. En effet, comment passer du processus délibératif au registre de l’action ?
Ce Courrier hebdomadaire met en évidence qu’une démocratie ne désigne pas qu’une procédure électorale activée à intervalles réguliers, mais un lieu de discussion où les idées se rencontrent, des hypothèses s’esquissent et où se cherchent des solutions pour éclairer une époque devenue obscure et illisible.
Alexandre Piraux
La désobéissance éthique
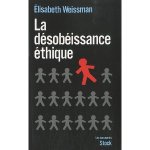
Ce livre soulève la délicate et passionnante question de la désobéissance au sein des services publics.
S’il est bien connu qu’en France, les agents sont obligés de désobéir et de ne pas exécuter des ordres manifestement illégaux ou irréguliers, sous peine de sanctions disciplinaires, la problématique de la désobéissance éthique se positionne en des termes différents. En effet, la désobéissance éthique donne préférence à la conscience morale individuelle par rapport à la loi. Comme on s’en souviendra, Henry David Thoreau qui refusa de s’acquitter de l’impôt afin de protester contre l’Etat qui maintenait au XIXème siècle le système de l’esclavage des noirs, est considéré aujourd’hui comme le « père » de la désobéissance civile.
L’obéissance à la loi est pourtant un bon et nécessaire principe de vie collective structurant les sociétés démocratiques. Dès lors, comment fonder la désobéissance, a fortiori dans le chef de fonctionnaires gardiens de l’intérêt public ?
L’ouvrage de Elisabeth Weissman qui est essayiste et journaliste, s’adosse à une enquête de terrain qui relate des témoignages impressionnants de ces fonctionnaires « désobéisseurs ». Il s’agit d’enseignants refusant de ficher leurs élèves, de forestiers freinant le marquage d’arbres trop jeunes qu’on leur demande d’abattre pour augmenter le chiffre d’affaires de l’Office national des Forêts, au détriment de la protection de l’environnement, de conseillers de Pôle Emploi ne dénonçant pas les demandeurs d’emploi sans papiers, ou des policiers qui ne procèdent pas à des interpellations injustifiées pour faire du chiffre. D’autres agents exercent leur droit de retrait en refusant de vérifier l’authenticité des papiers d’identité à l’insu du demandeur d’emploi, des postiers continuent à aider clandestinement à remplir les documents de personnes fragilisées et ce, à l’encontre des nouvelles méthodes de travail. A quelques exceptions près, le monde syndical traditionnel est, selon l’auteure, absent ou en porte-à -faux vis-à -vis de ces nouvelles pratiques alors que le rôle du « collectif » est crucial, notamment pour partager, discuter, confronter les questions liées aux valeurs et donc en fin de compte à l’éthique.
La conscience morale de chacun qui est par nature subjective et variable, ne saurait suffire à autoriser une transgression légale. Aussi les désobéisseurs justifient-ils la transgression de la norme juridique au nom d’une loi supérieure implicite ou explicite. Dans ce raisonnement, la légitimité reposant sur des valeurs l’emporte sur la légalité.
Il est un peu dommage que le livre, en forme de plaidoyer, n’opère pas de distinction graduée entre la désobéissance et la résistance, ne pose pas la question des limites à ces formes d’objection de conscience et reste cantonné dans la sphère franco-française. Regrettable aussi, le fait que certaines outrances affaiblissent la portée des témoignages courageux et transforment l’ouvrage en pamphlet anti-Sarkozy.
Néanmoins, l’originalité de la thématique et les enjeux qu’elle porte justifie, selon nous, la lecture de cette enquête.
Alexandre Piraux
Pourquoi nous n’aimons pas la démocratie

La démocratie est indissociable du questionnement. Interrogation que n’ont cessé d’affronter les plus grands penseurs politiques modernes. Les questions relatives à l’essence de la démocratie sont abordées aujourd’hui dans un contexte où certains s’inquiètent d’un changement de régime. Pour la politologue Wendy Brown, si la démocratie jouit aujourd’hui d’une popularité sans précédent, elle n’a jamais été plus vague conceptuellement et plus substantiellement creuse (Brown, 2009). Il y a là matière à alimenter de nouvelles contributions. Ainsi, le livre publié aux éditions "La fabrique", intitulé Démocratie, dans quel état, entendait, en sollicitant des auteurs tels que Giorgio Agamben, Alain Badiou, Daniel Bensaïd, Wendy Brown, Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière, Kristin Ross et Slavoj Zizek, lancer "des idées non conformes au discours habituel".
L’ouvrage de Myriam Revault d’Allonnes, Pourquoi nous n’aimons pas la démocratie, adopte une perspective plus libérale. Ce qui ne l’empêche pas, à l’instar de plusieurs des auteurs du livre de "La fabrique", tels Rancière, Bensaïd, Nancy ou Ross, de se demander si "la démocratie n’est pas un de ces "signifiants flottants" susceptibles de se charger de n’importe quel contenu symbolique". Mais le recours à Claude Lefort l’incite à penser que la polysémie du terme "démocratie" n’est pas seulement l’effet d’une insuffisance ou d’un flottement sémantique mais qu’elle résulte aussi de l’expérience d’une société insaisissable. Car, dès son avènement, la société démocratique s’est trouvée confrontée "à la dissolution des repères de la certitude". Le pouvoir, selon Lefort, est devenu "un lieu vide", ceux qui l’exercent n’en étant que les détenteurs temporaires (Lefort, 1983). La démocratie est née du rejet de la domination monarchique et de la découverte collectivement partagée que le pouvoir n’appartient à personne. Avec la destruction du corps du roi lors de la révolution française, tombe la tête du grand corps politique que constituait la société d’Ancien Régime et se produit "une désincorporation des individus" (Lefort, 1983). La société démocratique se trouve de ce fait marquée par "une perte de substance" et le pouvoir, privé de garantie transcendante, est investi en permanence par le débat sur le légitime et l’illégitime. Revault d’Allonnes ajoute que non seulement la démocratie repose sur le principe de division mais qu’elle y incite. Les conflits qui traversent la société, la persistance et le renouvellement des luttes sont inhérents à la société démocratique, non pas seulement, explique-t-elle, comme la marge de liberté ou de manoeuvre qu’elle permet, mais comme l’expression de la division sociale qui l’habite. Lefort voit dans les totalitarismes modernes, habités par le fantasme d’un corps social soudé et d’une société délivrée de la division, une sorte de réponse à l’épreuve à laquelle sont soumis les sujets démocratiques (Lefort, 1976). Revault d’Allonnes remarque que, si les tentatives pour "refaire du corps" sont des dispositifs conjuratoires face à la menace de l’indétermination démocratique, de tels dispositifs se sont très vite mis en place de l’intérieur même des sociétés démocratiques dès la chute des systèmes totalitaires. Elle relève ainsi la complémentarité entre les ouvrages de Fukuyama, La Fin de l’histoire et le Dernier Homme et de Huntington, Le Choc des civilisations. Elle voit en effet dans ceux-ci des démarches pour fixer l’identité démocratique, soit par l’homogénéisation universelle, soit par le reserrement et le recentrage d’une identité spécifique face à une extériorité menaçante. Elle prend acte de leur échec à toutes deux : l’incertitude n’a cessé de progresser, les processus de déliaison, de décomposition se sont amplifiés sur tous les fronts. Soulignant la différence essentielle entre la reconnaissance d’une fragilité qui, malgré l’absence de garanties ultimes, ne nous interdit pas d’orienter notre action et le sentiment d’une existence dangereuse, toujours menacée, elle exprime sa préoccupation : "comment l’incertitude qui, en sens, faisait vivre la dynamique démocratique (car la démocratie est toujours "à venir") s’est-elle pervertie en une véritable hantise de l’insécurité, de la peur et de la recherche de sécurité ?"
La démocratie est plus qu’une forme juridico-politique, elle est aussi un horizon de sens et une expérience. Et Revault d’Allonnes précise : qui dit expérience dit aussi expérience subjective, dispositions et positions subjectives. Or, si Lefort nous livre des indications sur les processus de subjectivation propres à l’Ancien Régime ou aux systèmes totalitaires, on ne trouve pas chez lui d’analyse de la subjectivation démocratique. Revault d’Allonnes va dès lors se tourner vers Foucault et sa mise en cause du caractère substantiel du pouvoir. Foucault décompose en effet le pouvoir en une multiplicité de relations qui traversent, caractérisent et même constituent le corps social. Et il substitue à la question : "qu’est-ce que le pouvoir ?" cette autre question : "comment le pouvoir s’exerce-t-il ?" (Foucault, 1994). La théorie de la souveraineté qui envisage le pouvoir comme dérivant d’un foyer unique ne lui semble pas pertinente pour décrire les nouvelles modalités d’exercice de celui-ci. Observant que le pouvoir opère à partir de nombreux points, aussi "d’en-bas", et ne se réduit pas à l’opposition binaire entre dominants et dominés, Foucault juge utile d’étendre le questionnement sur la gouvernementabilité et cela jusqu’à y intégrer le rapport de soi à soi. Car, estime-t-il, les stratégies que les individus entretiennent les uns avec les autres dépendent d’abord de leur liberté. Pour Foucault, le pouvoir a un caractère productif : il construit des identités, transforme la postion des sujets et leurs discours. Mais Foucault pressent également l’action que les sujets exercent en retour sur le pouvoir par leur autocréation, leur autoproduction. Il n’y a pas de "face-à -face de pouvoir et de liberté" régi par un rapport d’exclusion réciproque mais "un jeu beaucoup plus complexe" où la liberté apparaît comme "condition d’existence du pouvoir", à la fois son "préalable" et son "support permanent" – sa disparition provoquant l’anéantissement du pouvoir en tant que tel et son remplacement par la pure contrainte(Foucault, 1994).
Le constat foucaldien selon lequel toute domination repose non sur la seule contrainte mais aussi sur un minimum de "volonté d’obéir" est également présent chez Max Weber. L’illustre sociologue allemand observe que la rationalité selon les fins, à savoir la recherche de l’efficacité et de la concordance entre les moyens et les fins, régit le monde occidental. Ce type de rationalité s’est imposé parallèlement à la sortie de l’orbite religieuse et des forces et séductions magiques –le "désenchantement du monde" (Weber, 2003). Mais l’emprise croissante de la rationalité selon les fins ne fait pas disparaître la rationalité selon les valeurs (Weber, 1995). Aucune action politique –qu’elle émane du dirigeant ou du citoyen - ne peut se régler entièrement sur des critères d’efficacité sous peine d’être soupçonnée d’être à la limite a- ou anti-politique. Les institutions et l’Etat ne peuvent donc fonder leur légitimité sur la seule rationalité selon les fins. Weber, remarque Revault d’Allonnes, noue sans cesse la requête de légitimité qui émane de l’Etat et la réponse (ou la demande) qui lui est adressée par les sujets. D’où l’intervention de la "croyance", entendue au sens large comme l’ensemble des modes de subjectivation (affects et représentation). La mise en oeuvre d’un système de domination n’est donc pas seulement un effet de la capacité d’imposition du pouvoir, elle est aussi un effet de la croyance des individus en cette même capacité. Weber distingue trois types "purs" de domination qui sont chacun étayés sur la croyance. Mais si les dominations traditionnelle et charismatique impliquent un mode de reconnaissance liée à la personne, il n’en va pas de même pour la domination légale-rationnelle qui repose sur la confiance en la codification, la régularité, la précision et la compétence objective du système. Comment expliquer alors la résurgence d’épisodes charismatiques au sein de la modernité, l’irruption récurrente des "dominants charismatiques" – démagogues, chefs de partis, dirigeants révolutionnaires ? La persistance de tels phénomènes attesterait de la subsistance d’un résidu d’irrationalité au sein même des formes apparemment les plus achevées (Weber, 1995). Mais, plutôt qu’à un résidu, Revault d’Allonnes attribue l’irrationalité persistante au sein de la rationalité maximale vers laquelle tendrait la modernité à la part de l’irréductible à cette rationalité, laquelle se dégage des travaux de Weber, Foucault et Lefort. Du fait que l’homme moderne se trouve aux prises avec des choix contradictoires qui ne s’imposent plus à lui avec une évidence incontestée, la démocratie n’est pas réductible à son fonctionnement procédural. Son exercice s’accompagne nécessairement d’un horizon de choix, de valeurs, de conflits faisant souvent appel à des affects élémentaires. C’est donc le sens de la pluralité propre à la démocratie qui fait obstacle, pour Revault d’allonnes, à la cohérence visée par la rationalité politique calculante.
On assiste depuis les dernières décennies à l’entreprise néo-libérale d’homogénéiser, de réunifier l’homme moderne. Revault d’ Allonnes ne considère pas le néo-libéralisme comme une accentuation du libéralisme classique mais bien comme une nouvelle rationalité politique. Le libéralisme instaure un rapport mouvant entre le pouvoir et la liberté, celui-là devant à la fois produire celle-ci et la réguler. Il ne repose pas seulement sur l’harmonie des intérêts mais ouvre aussi la possibilité d’une brèche entre le sujet d’intérêt et le sujet moral. Le néo-libéralisme, quant à lui, entend soumettre toutes les dimensions de l’expérience contemporaine (y compris le politique) à la rationalité économique. Il conçoit l’être humain comme un "homo oeconomicus" et envisage son expérience comme entièrement régie par la rationalité calculante. L’économie de marché n’y est plus un principe de limitation de l’Etat, "mais le principe de régulation interne de bout en bout de son existence et de son action" (Foucault, 1994) si bien que l’Etat est placé sous la surveillance du marché et non plus l’inverse. Revault d’Allonnes décèle dans l’émergence de la notion de "gouvernance", une inflexion significative en ce qu’elle assimile le fonctionnement de l’Etat (et du politique) à celui de l’entreprise. Le politologue Guy Hermet avait émis un diagnostic analogue et mis en lumière la liaison entre cette notion – à laquelle les instances européennes ont donné une substance élaborée - et la théorie néo-libérale des choix rationnels (Hermet, 2007). Dans un tel Etat managérial, poursuit Revault d’Allonnes, la référence au "bien commun" s’est effacée au profit du rapport entre les moyens et les résultats, mesuré de façon quantifiable. La concurrence devient alors la seule norme de comportement qui vaille, se substituant à l’échange, qui est la norme de la société libérale et que Revault d’Allonnes ne réduit pas à l’échange économique. On n’échange pas seulement des biens, précise-t-elle, mais aussi des mots, des paroles, des arguments, des savoirs, des biens symboliques et culturels. Une nouvelle anthropologie se met ainsi en place où les notions d’intérêt et de concurrence règlent aussi bien l’action individuelle que collective, restreignant de fait la pluralité des formes d’existence des individus. De nouveaux paramètres d’évaluation sont introduits dans toutes les sphères de la société, même celles qui touchent à des biens communs irréductibles au calcul économique : justice, hôpital, psychiatrie, culture, Université. [1] Les résistances à cette mutation [2] sont discréditées au nom de la "modernisation", qualifiées de corporatistes, conservatrices, rétrogrades, passéistes. Or, s’indigne Revault d’Allonnes, leur commun dénominateur n’est pas la défense des avantages acquis ou de privilèges, mais bien l’opposition à l’idée selon laquelle toutes les sphères de la société peuvent être soumises au même type de rapport de pouvoir, c’est-à -dire aux critères du management. L’extension de la rationnalité économique à des domaines censés lui échapper jusque-là , conduit le néo-libéralisme à façonner normativement les individus comme des "acteurs entrepreneurs" et à s’adresser à eux sur ce mode dans tous les domaines de la vie.
Le tableau que nous dresse Revault d’Allonnes de l’évolution de nos sociétés est d’une implacable lucidité. Il est aussi précieux. Car si le néo-libéralisme inspire de façon croissante les politiques publiques, dans certains pays européens, il n’avance pas à visage découvert. Le politologue allemand Detlef Sack souligne qu’outre-Rhin le discours officiel y fait peu référence (Sack, 2008). Et les hommes politiques qui se sont identifiés à lui en France, tel Alain Madelin, ont obtenu de piètres résultats électoraux. Pourtant, les idées néo-libérales ont pénétré les grands partis politiques, y compris ceux qui se positionnent sur la gauche de l’échiquier politique – rappelons, en Belgique, le rôle moteur joué par les socialistes flamands dans la "modernisation" des services publics. Avec d’autres auteurs, Revault d’Allonnes fait donc oeuvre utile en retraçant la filiation néo-libérale de certaines notions et pratiques. Peut-être s’expose-t-elle au reproche de ne pas intégrer dans sa réflexion sur la démocratie la montée de la démagogie et de la xénophobie. Elle ouvre cependant une piste dans cette direction quand elle souligne l’accentuation de la logique de similitude dans le jeu politique. Zizek illustre une telle tendance en mettant en exergue le pari pris par Berlusconi que la population va s’identifier à lui dans la mesure où il incarne ou représente l’Italien moyen (Zizek, 2009). On pourrait cependant se demander avec Hermet si une complémentarité du populisme et de la gouvernance n’est pas en passe de se créer, si l’on n’assiste pas à un partage des tâches entre deux modes de traitement des affaires publiques : "d’une part une pratique populiste et plébiscitaire au niveau de la compétition électorale assortie d’un recours à la "démocratie participative" dans les affaires locales abandonnées en partie aux représentants autoproclamés de la "société civile" ; d’autre part des méthodes relevant de la gouvernance, réservées au petit nombre, s’agissant des orientations économiques, sociales ou politiques d’envergure nationale, régionale ou globale négociées entre des acteurs cooptés protégés des humeurs trop volatiles des électeurs" (Hermet. 2007).
Revault d’Allonnes admet que la démocratie libérale fixe des "limites" aux visées de la politique, qu’elle apparaît comme la forme politique des promesses non tenues ou intenables. Telle est la raison à laquelle elle impute le fait que la gauche ne l’a jamais vraiment aimée. Mais, fait-elle remarquer, dans la rationalité néo-libérale, qui ne vise qu’à la performance, l’horizon de la promesse est totalement absent. Au moment donc où nous voyons la démocratie libérale nous échapper, nous sommes simultanément amenés à reconnaître que "nous ne pouvons pas ne pas la vouloir". Dans le sillage de Walter Benjamin, elle incite donc à "résister à la mélancolie de gauche", c’est-à -dire, à se questionner sur les dispositions subjectives qui fondent la critique de gauche de la démocratie libérale.
Bibliographie
Agamben, G., Badiou, A., Bensaïd, Brown, W., D., Nancy, J.-L., Rancière, J., Ross, K., Zizek, S., Démocratie, dans quel état, Paris, La fabrique, 2009.
L’Appel des appels. Pour une insurrection des consciences, s.dir. Gori, R. , Cassin, B., Laval, C.., Fayard, 2009.
Brown, W., “Nous sommes tous démocrates à présent” , in Agamben, G., Badiou, A., Bensaïd, Brown, W., D., Nancy, J.-L., Rancière, J., Ross, K., Zizek, op. cit.
Foucault, M., Dits et Ecrits, Paris, Gallimard, 1994, t.IV.
Hermet, G., L’hiver de la démocratie ou le nouveau régime, Paris, Armand Colin, 2007.
Lefort, C., Un homme en trop. Réflexions sur “l’Archipel du Goulag” , Paris, Seuil, 1976.
Lefort, C., L’invention démocratique, Paris, Librairie générale française, “LeLivre de poche” , 1983.
Lefort, C., Essais sur le politique, Paris, Seuil, 1986.
Pyramides, 11, 2006/1.
Pyramides, 12, 2006/2.
Pyramides, 14, 2007/2.
Revault d’Allonnes, M., Pourquoi nous n’aimons pas la démocratie, Paris, Seuil, 2010.
Sack, D., “Le management néolibéral en Allemagne” , Esprit, décembre 2008.
Weber, M., Economie et Société, Paris, Pocket, 1995.
Weber, M., Le savant et le Politique, Paris, La découverte, 2003.
Zizek., S., Après la tragédie, la farce ! Ou comment l’histoire se répète, Paris, Flammarion, 2010.
Jean-Paul Nassaux
Recension. Le paraétatisme. Nouveaux regards sur la décentralisation fonctionnelle en Belgique et dans les institutions européennes

Cet ouvrage collectif publie les actes du colloque du 19 novembre 2010 sur le paraétatisme aux FUSL. Il revêt certainement un aspect très technique dans le sens de juridique. Cependant il serait faux d’en déduire que sa lecture est réservée aux seuls spécialistes du droit administratif. Un public plus large est potentiellement concerné. En effet, une série de contributions revêtent une portée plus étendue et retiendront l’attention de tous ceux qui s’intéressent à la gestion publique. Nous pensons ici à la contribution de Steve Troupin, Koen Verhoest et de Jan Rommel sur les leçons d’expériences internationales de décentralisation fonctionnelle, à celle de Dimitri Yernault et de Benjamin Cadranel qui dressent une cartographie institutionnelle, chronologique et exhaustive des pararégionaux bruxellois en partant du Port de Bruxelles (1895) jusqu’à l’Agence régionale de stationnement (2009). Les articles de Julien De Beys sur les agences européennes et de Koen Verhoest, Frederik Vandendriessche et Jan Rommel sur l’autonomisation (verzelfstandiging) en Flandre sont des textes de sciences administratives. Enfin, l’introduction de Pierre-Olivier Debroux, avocat et historien donne une impressionnante vue synoptique. Cet auteur souligne qu’une des conséquences de l’européanisation des services publics est la tendance à un rapprochement des modes de gestion des institutions publiques avec les règles et les formes de droit commun. Ainsi que l’ont écrit Michel Van de Kerchove et François Ost [1] (2002) « L’opposition traditionnelle entre l’intérêt général et les intérêts privés fait place à une conscience beaucoup plus nette de leur nécessaire enchevêtrement …. ». Les autres contributions feront le bonheur des publicistes qui pourront actualiser et peaufiner leur expertise sur l’autonomie avec ou sans personnalité juridique (Irène Mathy), la décentralisation en Région wallonne et en Communauté française (Marc Nihoul et François-Xavier Barcena), les ASBL de pouvoirs publics (François Belleflamme), le recours abusif aux contractuels dans les organismes publics (Jean Jacqmain), les contrats de gestion et d’administration (David De Roy), la décentralisation et le droit européen de la concurrence, des aides d’Etat, et des marchés publics (Pierre Nihoul).
La décentralisation a toujours été caractérisée par une grande hétérogénéité dans les formes et les statuts juridiques empruntés par les organismes publics.
En ce XXIe siècle c’est plus que jamais le cas et la diversification des statuts est qualifiée d’« extrême » et de « débridée ».
Diverses raisons sont à l’origine de ce phénomène : outre la fédéralisation du pays qui a amplifié le phénomène, on citera des raisons politiques de visibilité et de crédibilité de l’action publique, la volonté de ne pas dépasser une masse critique en personnel centralisé (cf le cas de la Commission européenne avec ses 40 000 agents qui a créé de nombreuses agences exécutives), et des raisons plus récentes comme la débudgétisation dérivant de la classification SEC95 qui fait que des emprunts sont confiés à des organismes et sociétés publiques pour respecter les critères d’endettement du Traité de Maastricht. Dans certains cas de dissension au sein des autorités publiques, la création de l’agence ou de l’observatoire permet de techniciser le débat et de collecter des données (cf l’exemple de l’observatoire européen des drogues et des toxicomanies) en attendant une prise de décision.
La nouvelle décentralisation fonctionnelle est marquée par la conclusion de contrat de gestion (1991) d’administration (1997) et même d’accord de coopération (décret-cadre de 2003) entre l’agence autonomisée externe de droit privé (EVA) qui est la forme la plus poussée de décentralisation et le gouvernement flamand. Le ou (la) mode contractuel(le) installe un pilotage par les résultats sur la base d’indicateurs notamment financiers, en lieu et place de la tutelle classique visant le respect de la loi ou de l’intérêt général. Dans la plupart des cas, on assiste à un cumul du pilotage par les résultats avec le traditionnel contrôle de tutelle. Il semble bien que le paradoxe de l’« agentification » soit celui d’une fausse autonomie, c’est-à -dire une autonomie théorique mais des contrôles stricts renforcés de toute nature. Le pilotage par les résultats a donc des difficultés à trouver sa place : généralement il se superpose aux traditionnels contrôles hiérarchiques ou de tutelle, plus rarement, il se substitue aux contrôles classiques ce qui entraîne un déficit de pilotage politique.
Différents constats de spécialistes sont convergents, « quelque chose est en train d’émerger », les distinctions traditionnelles continuent à être de plus en plus confuses. Les formes d’organisation de l’administration, en interne et en externe, sont hybrides. Les auteurs des conclusions générales, Bruno Lombaert et François Tulkens se risquent à l’hypothèse selon laquelle le paraétatisme serait un phénomène qui ne remplace pas les modes d’organisation de l’Etat, mais les transforme peu à peu.
Le paraétatisme est en effet organisé par des normes et statuts considérés comme légitimes mais qui déjouent toutefois les schémas légaux traditionnels. Selon les auteurs, le paraétatisme s’est développé « en marge des pouvoirs » et illustre le concept de « paralégalité » théorisé en particulier par Hugues Dumont. Pour rappel, cette notion désigne des normes considérées comme légitimes par un groupe social mais dont certaines sont contre les règles de droit existantes. En tout état de cause, la tension entre autonomie et contrôle est indissociable du concept de la décentralisation fonctionnelle et provient des important enjeux politiques qui accompagnent les activités confiées à l’organisme concerné.
La question de la nature publique ou privée d’une institution (A.S.B.L., société) reçoit rarement une réponse claire et absolue. Comme l’a développé le Professeur Vandendriessche (R.U.G.), dans sa thèse de doctorat, il ne s’agit pas de choisir entre le public et le privé, mais « plutôt de situer un organisme sur un continuum dont la personne publique pure et la personne privée pure seraient les deux pôles opposés ».
Comme on pourra le constater, cet ouvrage au-delà de certains aspects plus austères et purement juridiques, a le grand mérite de susciter une réflexion stimulante sur les nouveaux instruments de gestion publique et de relancer le débat à ce sujet.
Alexandre Piraux
Dictionnaire des politiques publiques

Le Dictionnaire des politiques publiques de Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot et Pauline Ravinet (dir.) est un ouvrage synthétique et pratique à destination des chercheurs, des politistes mais aussi des professionnels. Une troisième édition actualisée et augmentée vient de paraître, en septembre 2010. Ce travail collectif compte une soixantaine d’entrées reprenant les principaux concepts clés de l’analyse des politiques publiques. L’ouvrage explique l’origine du concept, son développement, ses usages, ses enjeux et les débats qu’il suscite. Les responsables ont aussi veillé à assurer une répartition équilibrée des courants et approches représentant leur discipline.
Une des originalités est d’avoir fait appel aussi bien aux plus grands spécialistes (parfois eux-mêmes auteurs de nouveaux concepts), qu’à de jeunes chercheurs. Parmi les contributeurs les plus éminents, mentionnons Philippe Bezes, Patrice Duran, Jean Leca, Christine Musselin (rencontrée et interrogée par Luc Wilkin pour Pyramides n° 14 au sujet de la réforme des universités), Patrick Lascoumes, Patrick Le Galès, Pierre Muller, Jean-Claude Thoenig , Philippe Warin, etc.. Pour le monde anglo-saxon, on note B. Guy Peters, Paul Sabatier et Mark Thatcher. Steve Jacob, Professeur à l’Université de Laval, qui a été chercheur au CERAP et est membre du Comité scientifique de la revue Pyramides a assuré la notice sur l’évaluation.
Ce livre dépasse un approche franco-française de l’action publique et intègre les courants d’analyse internationaux. Une certaine forme de pluralisme théorique présentant des grilles de lecture différentes voire opposées est ainsi privilégiée avec succès et ouvre des perspectives, en termes de débats théorique et méthodologique.
Conçu comme une « boîte à outils », cet ouvrage de synthèse aborde des concepts émergeant dans le langage courant comme européanisation, gouvernance, évaluation, mise à l’agenda, nouveau management public. Au sujet de ce dernier concept, la lecture de la notice est sans doute à entreprendre en ayant à l’esprit que l’éminent contributeur, B. Guy Peters, Professeur à l’Université de Pittsburgh, analyse la notion de nouveau management public, son impact sur l’administration, ses limites et ses perspectives au regard de la situation de son pays. Selon B. Guy Peters, le NMP est souvent appréhendé en termes de management générique (generic management) ce qui présuppose une similarité entre management public et management privé. Comme apports positifs, l’éminent contributeur d’outre-Atlantique estime que le secteur public est devenu plus efficace et efficient qu’avant l’introduction de ces réformes (moins de personnes pour fournir les mêmes prestations), que les services tendent à être distribués plus rapidement et soulever moins de plaintes. Parallèlement, les apports négatifs peuvent se résumer comme suit, selon l’auteur : en tout premier lieu un abandon des formes traditionnelles de responsabilité des managers par rapport aux élus, ensuite une accentuation des problèmes de coordination, puis la perte d’une part importante de la mémoire organisationnelle du secteur public en raison de la modification des structures de carrière, et enfin des difficultés de contrôle et de surveillance des services dues à l’intervention accrue du secteur privé dans l’administration. Et l’auteur de prudemment conclure qu’ « il incombe aux gouvernements de décider si les bénéfices apportés par le NMP sont supérieurs aux coûts imposés ».
Les notions plus anciennes comme Etat (décrit et commenté avec érudition dans toutes ses conceptions comme être et comme faire par Jean Leca), expertise, groupe d’intérêt ne sont pas mises de côté, mais au contraire revisitées. Elles rendent compte des transformations radicales dans la façon de se représenter et de penser la gestion de la res publica.
Malgré la difficulté d’une approche exclusivement conceptuelle, on ne saurait que vous recommander l’acquisition de cet ouvrage de référence très clair, dans les plus brefs délais, pour autant bien sûr que la construction des politiques publiques et la gestion de la cité vous intéressent…
Alexandre Piraux
Les musées au musée ? Le patrimoine entre poussière et commerce

Conservation du patrimoine, éducation populaire, recherche scientifique, les missions du Musée se sont élargies au fil du temps. Doivent-elles également s’étendre au développement économique et touristique ?
Politique, revue de débats, numéro 70, mai-juin 2011
Lien vers le site de Politique
Le bimestriel Politique revue de débats consacre son numéro 70 de mai-juin 2011 au thème des musées « Les musées au musée ? Le patrimoine entre poussière et commerce ». On mentionnera le très intéressant article de André Gob, archéologue et muséologue, Professeur à l’Université de Liège, « Des musées au service des politiques ». Ce dernier reprend une formule de Michel Colardelle, « Le musée est un outil de doute », en ce qu’il cultive l’esprit critique et suscite des questionnements. A rebours, le discours politique a « l’ambition d’apporter des réponses et d’éteindre les doutes ». Il y a donc selon l’auteur, tension entre la mission scientifique du musée et une certaine logique politique. On épinglera aussi les entretiens avec le Recteur Didier Viviers qui est Professeur d’histoire et d’archéologie et Philippe Mettens, Président du Service Politique Fédéral Politique scientifique qui révèlent des visions divergentes du rôle des musées. Pour le dire brièvement, deux lignes muséales s’opposent, l’une universaliste (faire découvrir l’inconnu plutôt qu’approfondir un « déjà connu ») l’autre plus identitaire et managériale (attirer le public via un regroupement thématique).
Anne Morelli, quant à elle, s’interroge avec vivacité sur les causes du non aboutissement du Musée de l’immigration dans son texte « La lente agonie du Musée de l’Immigration ». En l’espace de dix ans, le projet de Musée de l’Immigration a été pensé, programmé, et semble finalement voué à être oublié face au peu d’enthousiasme de la majorité politique. De nombreux autres articles pertinents alimentent la réflexion sur la politique publique muséale ? Cette politique est notamment liée à la gestion du patrimoine publique et à une certaine conception de la culture. Cette question fait en réalité l’objet de trop peu de débats, ce qui rend d’autant plus présent l’intérêt de ce numéro de Politique. Les musées représentent en effet un important facteur d’éducation et de civilisation.
Alexandre Piraux
Qu’est-ce que le mérite ?

A l’heure où la méritocratie est de nouveau vantée, et mise en évidence en tant que valeur et comme critère de choix des meilleurs notamment dans les services publics, il nous a paru très intéressant de recenser un des rares ouvrages qui essaie d’objectiver ce mot-valise employé comme si il renvoyait à une évidence alors que sa définition recouvre au contraire des enjeux différents. Le mérite est pourtant brandi et revendiqué par tous.
L’auteur se demande ce que peut signifier le retour du mérite dans la mesure où il n’est plus question à l’heure actuelle « de valeur morale, d’accomplissements humains, de bonnes actions, de vertu ». Le mérite semble au contraire être « quelque chose qui doit payer ».
L’auteur examine le concept « épais » (thick) de mérite, « épais » en ce qu’il se compose d’ingrédients divers, historiques et conceptuels. Mais la notion de mérite est aussi analysée dans ses éléments constitutifs, ses justifications, ses réussites et échecs.
Yves MICHAUD constate que le système du mérite a commencé à partir du moment où face à la complexité, la société a eu besoin de compétences, et de spécialistes expérimentés. La naissance, les relations familiales, les recommandations familiales ne suffisaient plus. 1747 voit ainsi en France, la création de l’Ecole royale des ponts et chaussées qui permettra jusqu’à ce jour, l’éclosion de générations de brillants ingénieurs, hauts fonctionnaires de l’Etat.
Le souci technocratique de la compétence administrative n’est pas étrangère à l’esprit des Lumières. La révolution française va accélérer le processus de professionnalisation, pour le dire en termes d’aujourd’hui. L’Ecole polytechnique et l’Ecole normale supérieure seront crées en 1794.
A chacun sa capacité affirme l’ abbé SIEYES, député des états généraux et constituant en 1789. Selon ce dernier « Il faut pour toute espèce de service public, préférer les plus capables ». Il s’agit d’ un projet lumineux mais difficile à mettre en œuvre tant selon LA ROCHEFOUCAULD ( moraliste d’avant la révolution), les hommes récompensent plus les apparences du mérite que le mérite lui même. Les modalités d’évaluation des mérites au recrutement puis en cours de carrière et la définition des compétences requises resteront des difficultés rarement dépassées et toujours d’une grande actualité. Comme le note Yves MICHAUD « on ne note pas de la même manière une épreuve suivie par des milliers de candidats et une autre avec moins d’une centaine de concurrents ».
De façon surprenante, l’usage du terme mérite dans son sens professionnel apparaît seulement au début du XIXième siècle. Cela s’explique du fait que le mot mérite est connoté religieusement (les bonnes actions du fidèle et la Grâce divine).
Selon l’auteur, une contradiction de fond existe entre les différences de traitement que le mérite légitime et les exigences de l’égalité. De ce fait, la notion de mérite est passée en revue au prisme des théories de l’égalité (RAWLS, WALZER, SEN). D’après Yves MICHAUD, on serait peut-être allé trop loin en matière de doctrine de droits et de demande d’égalité, la maxime reine serait désormais « A chacun selon sa revendication ». Le mérite serait convoqué comme une sorte de correctif « sauf que ce correctif est verbal et, dans la pratique, inopérant ». En effet « Qu’est-ce que le mérite si on ne sait plus ce que sont les vertus ? ».
Par ailleurs, la complexité des situations et des systèmes et le rôle énorme de la chance dans la distribution des capacités de départ « fait douter des attributions de mérites ».
En guise de conclusion, Yves MICHAUD envisage un mérite élargi « portant sur les actions dans leur continuité et cohérence dans l’ensemble de la vie d’une personne. Ce n’est qu’à la mesure d’une vie et de son caractère vertueux que l’on pourrait identifier ce mérite élargi ».
On n’oserait pas écrire que l’ouvrage d’Yves MICHAUD est « méritant » dans le meilleur sens du terme car cela prêterait à confusion compte tenu du caractère « flou et incertain » du concept. Ce livre est en tout cas très stimulant et riche. Malheureusement, il est parfois trop aisé de se perdre dans les méandres de la démonstration.
Alexandre Piraux
Nouvelle Revue de Psychosociologie : Le management « hors sujet » ?

Cette livraison de la Nouvelles Revue de Psychosociologie est dédiée à la question du Sujet dans un cadre managérial. Une série d’articles éclairent de façon critique la « cohabitation difficile », « quasi impossible voire destructrice » entre le management et le Sujet.
Le management actuel est-il un management « hors sujet » s’interroge Nicole Aubert, à savoir un management qui ne prend pas en considération ce qui dans les individus sur lesquels il exerce son pouvoir, fait d’eux des sujets autonomes et singuliers. Cette phrase résume en quelques mots le questionnement et les enjeux de cette dernière livraison semestrielle.
D’emblée Nicole Aubert pose l’ambiguïté de la notion de « sujet », le vocable évoquant aussi bien l’idée d’assujettissement que celle d’autonomie. L’évolution sémantique fait toutefois que le « sujet » historiquement soumis, a acquis depuis le XIXème siècle la dimension philosophique de l’être pensant impliquant par là une conscience rationnelle. Un véritable renversement de sens s’est donc opéré.
Parmi les nombreuses contributions, nous en retiendrons trois orientées plus spécifiquement vers le secteur public ou l’associatif solidaire.
Gilles Herreros, Professeur de sociologie à l’université de Lyon2 dans son texte « Vers des organisations réflexives : pour un autre management » étudie un cas de harcèlement moral se situant dans une entreprise de l’Economie sociale et solidaire. A travers ce cas, c’est le discours institutionnel de l’entreprise de solidarité sociale qui est décodé et plus particulièrement son décalage par rapport à l’expérience vécue par les salariés. La confrontation au réel institutionnel provoque des dissonances et pour s’en protéger la plupart des cadres se réfugient dans l’adhésion non distanciée au discours institutionnel dé-réalisant.
Pour en sortir le contributeur propose une « utopie rationnelle » consistant en l’adoption par l’encadrement d’une posture clinico-critique. Le regard clinique implique de considérer d’abord qu’une situation est composée de sujets à la fois assujettis mais aussi capables de s’autonomiser desdits assujettissements. Le travail de négativité permet selon le contributeur de rendre intelligible des situations appréhendées dans toute leurs aspérités et complexités au lieu d’en rester à un discours institutionnel lisse et homogène. Pour qu’une organisation soit réflexive et ait de la sorte des perspectives, il est nécessaire que ses managers mobilisent des compétences nouvelles telles une posture critique et un travail de négativité intranquille pour faire face au réel.
Dans son article « Accompagner les encadrants publics pour soutenir leur processus de subjectivation au travail », Valérie Brunel, intervenante psychosociologue, s’appuie sur sa pratique clinique d’intervenante pour établir un constat de souffrance des managers publics. Elle veut toutefois aider les managers publics à occuper une place de sujet, c’est-à -dire à restaurer leur capacité d’agir et leur proposer un dispositif de soutien. Un premier principe pour elle est de s’appuyer sur le collectif de pairs afin de coconstruire de nouvelles valeurs et stratégies. Le second principe consiste à faciliter l’acquisition d’une pensée contextualisée et créative sur leur rôle de manager. Cela nécessite un net changement de regard pour des managers centrés sur l’action et la résolution de problèmes. Une fois de plus la réflexivité sert de « principal adjuvant » à la subjectivation et à l’innovation.
John Cultiaux, Chargé de cours à la Louvain School of Management s’intéresse aux thèmes de la reconnaissance, de la position de victime et de la résistance du sujet critique dans le processus de modernisation des entreprises publiques en Belgique dans son texte « Nouveau management public et sujet critique : enjeux idéologiques, collectifs et subjectifs » (cf. aussi Pyramides n° 10 et 17). L’auteur rappelle le compromis historique conclu entre la dynamique économique pilotée par la recherche du profit et le souci de protection sociale et de solidarité. Il constate que ce compromis a été brisé par la « société hypermoderne » caractérisée par la logique du marché et du profit exclusif.
Le contributeur vise à démontrer qu’un redéploiement de la critique sociale dans l’entreprise (in casu publique) loin d’être un obstacle, est un atout pour l’avènement d’une nouvelle entreprise publique. De fait la stimulation de la critique peut entraîner des effets positifs sur l’engagement de beaucoup de membres du personnel statutaires peu qualifiés qui ont été réduits au silence, empêchés d’exprimer leur expérience et mis en marge du système au prétexte de leur résistance au changement alors que la plupart désirent apporter leur expérience à l’entreprise.
On notera aussi la contribution de Bénédicte Vidaillet (Université de Lille 1) sur « Le sujet et sa demande d’être évalué : angoisse, jouissance et impasse symbolique ». L’auteure constate tout d’abord que l’évaluation n’est plus une facette du management mais en est devenu le pivot. Il y aurait chez les agents, une demande plus ou moins latente d’évaluation, demande d’évaluer et d’être évalué. Un chercheur comme Christophe Dejours pense à ce sujet que les gens y sont « foncièrement consentants ». Le problème est toujours selon le même chercheur que « dans l’état actuel des connaissances (…) il n’y a pas à ce jour d’évaluation objective possible ». Une des hypothèses de l’article est que la demande d’évaluation est une demande de définition identitaire pour répondre à l’angoissante question de « qui suis-je ? ». Pour ce faire, la présence d’un Autre consistant et cohérent est nécessaire. Selon la contributrice le fait de se référer à des outils et à des indicateurs sur lesquels le manager n’a pas de prise « dévalue sa parole et l’empêche d’assumer la place de l’énonciation. » Il en est de même pour les dispositifs d’auto-évaluation où on n’a plus besoin d’un regard extérieur ou de l’évaluation à 360°. Avec les pratiques actuelles d’évaluation qui agissent quasiment en continu, chaque place est relative et éphémère. Le jugement de l’Autre de l’évaluation (l’évaluateur) est provisoire, « sa parole ne tient pas, sa place elle même n’est pas définie de manière stable et ne constitue pas un point de référence ». Il est donc fondamental de réintroduire du Symbolique dans les organisations. Le regard et la voix de l’Autre jouent ici un rôle essentiel. Il y a lieu de réintroduire du Sujet dans les processus et ce même si « l’excès de Symbolique » peut emprisonner le sujet dans le désir tyrannique de l’Autre.
Un entretien avec Vincent de Gaulejac clôt la partie thématique et rappelle dans le prolongement des contributions que « l’utilité première du management réside dans son rôle de médiation des contradictions organisationnelles ». Cependant l’instrumentalisation de l’humain qui nie la subjectivité de l’agent, à des fins de performance et d’efficience illimitée ne permet évidemment pas la tenue de ce rôle de médiation.
Ce numéro donne l’impression globale que les aspects sociaux (humains et éthiques) et managériaux peuvent, moyennant certaines conditions, utilement se rejoindre et entrer en interrelation positive.
Alexandre Piraux
Repenser la gestion publique. Bilan et perspectives en Suisse

« Les administrations publiques sont suspectées par principe ». C’est à partir de ce constat de méfiance traditionnelle que David Giauque [1] et Yves Emery [2] analysent les mouvements réformateurs en Suisse, dans leur ouvrage « Repenser la gestion publique ». Les auteurs prennent l’histoire en marche, c’est-à -dire au début des années 1990, au moment où la Confédération helvétique connait une crise de ses finances publiques. Bien que la situation économique n’ait pas été aussi alarmante que dans des pays comme l’Allemagne, la France ou l’Italie, elle a été un des éléments déclencheurs d’une succession de mutations dans l’administration suisse. Surtout, le modèle classique wébérien, fondé sur des réformes au but économique et de gain de productivité, était arrivé à ses limites. Il fallait repenser l’action publique dans son ensemble, y ajouter la flexibilité et la réactivité pratiquées par les entreprises privées. L’époque est alors marquée par l’avènement de la Nouvelle Gestion Publique (NGP), plus souvent citée sous son appellation anglaise de New Public Management (NPM). Promue par des institutions internationales comme le FMI, l’OCDE et la Banque mondiale, ce concept néolibéral de gestion publique va faire des émules en Suisse. Dans leur ouvrage, David Giauque et Yves Emery approfondissent l’étude de son développement car, disent-ils, même si le modèle tombe en désuétude, il est décisif pour le pilotage des organisations publiques au 21ème siècle.
Et les auteurs de stipuler que la NGP, comme concept uniformément reconnu, n’existe pas. Il s’agit d’un catalogue d’approches et méthodes utilisées pour réformer l’administration. D’où l’absence, dans l’ouvrage, d’un bilan unique des expériences menées en Suisse, et l’impression de patchwork que le livre laisse parfois au lecteur. La NGP considère l’administré comme un client, faisant valoir ainsi les valeurs et les normes de la pensée managériale. Sur ce point, David Giauque et Yves Emery se demandent si l’on attache assez d’attention à l’état de nos connaissances sur ces pratiques et à leur adéquation au secteur public. C’est en cela que les auteurs critiquent les mutations faites jusqu’à présent, ou plus exactement, relèvent cette faille pour que les futures réformes tiennent davantage compte d’une dimension philosophique de la fonction publique. Sans pour autant rejeter la NGP, l’ouvrage souligne l’importance de « séparer le bon grain de l’ivraie ». Et de mettre en garde contre une « banalisation » de l’emploi public [3] qui en supprimerait les spécificités et la noblesse de l’exercice.
La décentralisation du système politico-administratif suisse offre une diversité d’innovations et un vaste champ d’étude de ses succès et de ses échecs. Sans se vouloir exhaustif, les auteurs ont repris en détail les cas de la Confédération, du Valais et du canton de Zurich. Retenons l’exemple du Valais où le projet de modernisation a réussi le pari d’intégrer le Parlement dans les procédures de contractualisation. Après une phase expérimentale entre 1996 et 2004, la période 2005-2008 correspond à une généralisation progressive de la gestion par mandats de prestations. Comme l’explique les auteurs, « la particularité de cet exemple réside dans le soutien indéfectible que les autorités politiques ont accordé au projet, tout à la fois le parlement et le gouvernement, ce qui a permis aux travaux d’avancer avec assurance. D’autre part, cette réforme peut être considérée comme « maison » dans la mesure où se sont les acteurs valaisans qui ont contribué à son développement. Il n’a été question à aucun moment de confier la réalisation des travaux à des experts ou consultants externes. Le Centre de management public, constitué d’experts de l’administration appartenant au canton, a été créé et soutenu par le Valais et il s’est pleinement engagé dans l’accompagnement de la réforme, lui fournissant les outils de la mise en œuvre et la nouvelle philosophie de gestion ». Malgré la complexité du système, l’homogénéité politique a permis l’efficacité de la réforme, ce qui n’est pas le cas d’autres cantons qui sont encore à la recherche d’un consensus en faveur des réformes.
La particularité helvétique est d’avoir focalisé d’emblée l’attention sur la globalité du système politico-administratif. Non sans mal, vu la faiblesse des services du parlement par rapport aux états-majors internes de l’administration, peut-on encore lire dans l’ouvrage. Le sentiment dominant chez les parlementaires est celui d’une perte de pouvoir. Quelques cantons sont allés même jusqu’à interrompre les expériences en cours (Bâle-Ville, Genève, St-Gall). Leur capacité de pilotage de l’administration ne s’est pas améliorée alors que leur volonté de poursuivre les pratiques de NGP est réelle. Un des défis pour l’avenir impliquerait une réforme des parlements et des outils juridiques mis à leur disposition, notent D. Giauque et Y. Emery. De leur côté, les gouvernements ont une attitude effacée. Une explication tient au système de collégialité suisse. Le collège exécutif n’intervient pas directement dans la gestion des affaires des départements. Cependant, ce constat a déclenché une évolution ces dernières années, les gouvernements s’engageant plus nettement avec le temps.
Pour conclure, les auteurs s’inspirent de la proposition de S.P. Osborne [4] qui plébiscite une « nouvelle gouvernance publique ». Celle-ci doit accorder autant d’importance aux mécanismes interinstitutionnels qu’aux processus intervenant à l’intérieur d’une organisation. La nouvelle gouvernance appelle à une meilleure compréhension du fonctionnement global de l’action publique et implique une volonté citoyenne de réaliser des prestations publiques. La réflexion doit se poursuivre jusqu’aux effets générés et à la « cohérence du système des affaires publiques ». Reprenant la typologie de Boltanski et Thévenot [5], les auteurs énoncent que l’approche traditionnelle de l’administration publique se référait au monde civique, celle de la NGP au monde marchand, alors que la nouvelle gouvernance publique se rapproche du monde des connexions et des réseaux. David Giauque et Yves Emery rejoignent l’idée « d’un Etat catalyseur de réseaux, tantôt dans une position de leadership formel et juridique, tantôt dans une position d’acteur subsidiaire face à l’économie et à la société civile ; un Etat plus « partenarial », agissant sur des modes diversifiés ». Ce qui renvoie à la question : comment se répartissent le pouvoir et la responsabilité dans des réseaux d’acteurs où l’autorité publique n’est plus qu’un partenaire parmi d’autres ? [6]
« Repenser la gestion publique » est un bilan, un tour d’horizon de ce que la NGP a pu apporter à l’administration suisse, en termes d’innovation. Sa lecture est utile pour celui qui désire appréhender les techniques de ce qu’il faut désormais appeler l’ancienne « nouvelle gestion publique ».
Florence Daury
De La Poste à bpost : histoire d’une mutation (1991-2015)

Courrier hebdomadaire du CRISP n° 2326-2327, par J. Vandewattyne, J. Cultiaux, R. Deruyver, 102 p., 2017
La période 1991-2015 marque une profonde mutation pour l’entreprise postale belge. En 1992, la Régie des Postes devient La Poste. Elle est rebaptisée bpost en 2010. Le premier changement de nom correspond à une importante modification de statut : la poste belge cesse d’être une administration d’État pour devenir une entreprise publique autonome. Le second symbolise la volonté de l’opérateur postal de se présenter comme étant apte à affronter l’avenir.
Les RH en scène. Comment recruter et sélectionner des candidats star

Recension de Florence Daury
Depuis quelques années, la politique du personnel traditionnelle s’est muée en un organe stratégique de plus en plus essentiel à l’entreprise, qu’elle soit privée ou publique. Aujourd’hui, une bonne gestion des ressources humaines doit assurer la pérennité de l’organisation mais aussi, objectif suprême loué par tous les spécialistes en ce domaine, le bonheur de ses travailleurs. « Les entreprises qui rendent leurs employés heureux sont celles qui attireront les meilleurs talents ». [1] Aux antipodes de la multiplication des contrats de travail « atypiques » (autres qu’un CDI), l’objectif d’une GRH efficace est de mettre la bonne personne à la bonne place et surtout, de la garder, en pratiquant une politique de rétention de son personnel qui se consacre au développement de chaque individu. Cette fidélité à l’organisation assure une faible rotation de l’emploi en son sein et contribue à améliorer l’image de l’entreprise. Son image, sa réputation ont acquis également une importance capitale aux yeux de ses membres et à ceux de ses clients/administrés. Voici donc rapidement planté le décor de notre monde du travail moderne.
Et de décor, justement, Marc Van Hemelrijck, patron du Selor [2], en parle bien dans Les RH en scène. Comment recruter et sélectionner les candidats star. Davantage manuel pratique qu’ouvrage de réflexion, le livre nous emmène dans une métaphore du cinéma en décrivant tous les stades de l’embauche comme on réaliserait un film, depuis le casting jusqu’à la nomination aux Oscars. Tout commence donc avec la construction du personnage ou, dit plus banalement, la définition du candidat idéal. « Il ne serait pas judicieux de mettre l’accent uniquement sur les diplômes. Les compétences doivent être au cœur du processus », explique l’auteur. Face à un monde du travail métamorphosé par les évolutions technologique, économique et sociale, face aux attentes nouvelles des travailleurs, l’entreprise doit améliorer sa recherche de personnel, de talents comme il est d’usage de le dire actuellement, en envisageant des alternatives à l’incontournable diplôme, du moins quand les compétences et/ou l’expérience peuvent le remplacer. Pour ce faire, chaque organisation peut développer à sa mesure un modèle de compétences, c’est-à -dire un outil qui lui permettra de définir le plus finement possible le profil dont elle a besoin et qui lui évitera le « mauvais casting ». A travers un cas pratique – qui est présenté à chaque chapitre – les éléments nécessaires à l’élaboration de ce modèle sont détaillés dans l’ouvrage, en particulier le modèle « 5+1 » de Hudson adopté par l’Administration fédérale belge. Conçu par le cabinet de recrutement Hudson, ce modèle « 5+1 » prend en compte cinq groupes de compétences comportementales (gestion de l’information, gestion des tâches, gestion des collaborateurs, gestion des relations, gestion de son fonctionnement personnel) et le « 1 » fait référence à un groupe de compétences techniques (connaissances bureautiques, aptitude technique, capacité à entretenir des machines, etc.). Le modèle a pour avantage de prendre en compte les compétences dans toute leur complexité et de classer ces compétences par ordre d’importance par rapport à la fonction à pourvoir. Chaque organisation a donc la possibilité d’adapter le modèle à ses exigences propres.
Confrontées au problème des métiers en pénurie, les entreprises doivent rivaliser entre elles pour attirer les meilleurs candidats. L’auteur profère, sur cette question de place à occuper sur le marché de l’emploi, quelques évidences comme l’importance d’être présent sur Internet, la prise en compte de la génération Y ou le choix correct des canaux de diffusion en fonction du groupe à cibler.
Au stade de l’analyse du CV, l’auteur privilégie le formulaire de candidature standardisé qui fait gagner du temps lors de la pré-sélection. Quelques exemples de formulaires d’évaluation sont donnés afin de comparer les CV aux exigences de la fonction.
La question de l’interview est, quant à elle, examinée de façon très complète et précise. Le chapitre définit avec finesse plusieurs types de motivation et comment l’évaluer. La méthode d’interview appliquée et promue par Marc Van Hemelrijck est la méthode STAR (Situation, Tâche, Action, Résultat). Les questions posées sont en rapport avec des situations professionnelles concrètes, afin d’évaluer le comportement humain en fonction de sa personne, son environnement et l’interaction entre ces deux variables. Des exemples de questions pertinentes, des conseils pour mieux conduire l’interview, ainsi que des avis et des principes sur l’évaluation des compétences sont apportés au lecteur.
Autre point abordé, les tests informatisés dont les entreprises font de plus en plus l’usage. Vu le coût de leur élaboration, il arrive souvent que ces tests soient développés en externe ou qu’il s’agisse de tests déjà utilisés par d’autres organisations. Dans tous les cas, il est bien sûr primordial de pouvoir juger de la qualité de ces tests, en fonction de critères délivrés dans l’ouvrage. Un bon test doit présenter les six caractéristiques suivantes : il doit être efficace, standardisé, objectif, normé, fidèle (stable dans le temps) et valide. Cette validité recouvre une importance particulière car elle mesure la corrélation entre le résultat d’un test et la performance professionnelle que le test cherche à prédire. L’ouvrage explique plus largement comment mesurer cette validité.
L’auteur présente également plusieurs modèles d’analyse de personnalité. Enfin, il décrit la méthode de l’Assessment Center que l’auteur définit ainsi : « Un assessment center est un processus d’évaluation dans le cadre duquel un individu ou un groupe d’individus est évalué par plusieurs (assesseurs) qui appliquent à cette fin une série intégrée de techniques. Les simulations, l’observation du comportement formant à cet égard la base de l’évaluation, représentent un élément essentiel des techniques appliquées. Les résultats d’un assessment center permettent de tirer des conclusions en matière de sélection, de planification de carrière, d’évaluation du potentiel, de la détection des besoins en matière de formation, etc. ». A travers cette définition, on voit non seulement la technicité élevée du processus d’embauche, mais également la responsabilité grandissante de la GRH au fonctionnement de toute organisation.
Concluons avec la particularité, à mon sens, la plus révélatrice de l’esprit de l’ouvrage de Marc Van Hemelrijck : l’utilisation d’un logo « pro-diversity ». Ce logo est présent tout au long des chapitres et les réflexions concernant cette quête de diversité sont reprises en annexe du livre. De précieux conseils vont permettre aux gestionnaires des ressources humaines de considérer les candidats avec équité, de fournir aux personnes avec un trouble, un handicap ou une maladie les informations qui leur permettront de s’autoévaluer face aux exigences, lorsque, par exemple, la fonction présente la nécessité de pouvoir voir, entendre ou se déplacer. Cette attention particulière accordée à la diversité participe à la qualité de l’image et à l’attractivité d’une organisation. Toutefois, l’auteur prévient : « Une diversité de façade a souvent pour conséquence que les personnes des groupes cibles accumulent expériences négatives et frustrations, puis décrochent rapidement ».
Lorsqu’il aborde le sujet des tendances actuelles sur le marché du travail, l’auteur enfonce quelques portes ouvertes : « En temps de crise, la sécurité de l’emploi est importante » est une formule connue qui mériterait quelques nuances ou quelques précisions sur la façon de garantir cette sécurité. Mais le propos n’est pas là . Avec sa bibliographie très vaste, les multiples tableaux qui appuient les méthodes mises en avant, le livre présenté ici s’adresse principalement aux professionnels de la GRH. Il est un compagnon utile et complet pour chaque stade de la sélection et du recrutement des talents au travail. De ce point de vue, il s’agit bien d’un ouvrage de référence.
Revue Esprit, « Les mirages de l’excellence », n°7, juillet 2012.

« Les revues, l’évaluation et l’espace public intellectuel », Marc-Olivier Padis
L’excellence est devenue au cours de l’évolution de la réforme de l’enseignement supérieur en France, un terme clé des annonces ministérielles. Comme le note Marc-Olivier Padis, Rédacteur en chef de la revue Esprit : « Le terme par définition attractif et vague, est propre aux instrumentalisations : l’excellence est à la fois présentée comme un projet de promotion de la recherche française au niveau international et un label, quand il donne droit à des financements particuliers ».
Si on met de côté les refus de principe de l’évaluation ou les aspects méthodologiques souvent trop formels, une approche contradictoire et dès lors un vrai débat démocratique manquent.
La question de l’évaluation est d’autant plus importante que les procédures d’évaluation se sont, comme on le sait, étendues à toutes les professions et ne concernent plus seulement les cadres mais la moitié des salariés en France, sans oublier à un niveau macro l’évaluation des politiques publiques.
La partie thématique de la revue est consacrée principalement au rôle et à l’usage de l’évaluation dans l’enseignement supérieur. Ainsi le numéro contient-il des textes sur les mathématiques à l’épreuve de l’ « excellence », le déséquilibre de l’évaluation entre les sciences humaines et les sciences exactes, les stratégies d’excellence comme un risque de fragmentation pour les universités ?, etc….
A cet égard l’auteur de l’introduction rejoint la contributrice Eve Chiapello qui dans son article « Ecoles de commerce : la pression de l’internationalisation » constate que les écoles d’économie et de gestion « … adaptent leurs stratégies à des évaluations exogènes puissantes, qui sont celles de la mobilité internationale des étudiants et des offres d’emploi ». Dans ce cas, évaluation et contraintes extérieures se confondent.
L’évaluation même imparfaite s’impose avec force, parce qu’elle fournit « des repères minimaux dans un monde peu lisible ». Mais « L’ironie est que les indicateurs, mal compris et utilisés, contribuent à plus d’opacité… ».
L’article de Marc-Olivier Padis sur les revues académiques a retenu plus spécialement notre attention.
La publication d’articles de recherches dans des revues savantes est devenue un indicateur essentiel de performance (dans le processus d’évaluation). C’est pour cette raison que le statut des articles de recherche se transforme.
Les objectifs poursuivis par l’évaluation sont généralement considérés comme légitimes (bonne allocation des ressources, limitation de l’arbitraire hiérarchique, etc…) mais alors comment se fait-il que l’évaluation suscite tant de débats se demande l’auteur.
Dans les faits, on est passé d’une évaluation professionnelle (par les pairs) référant aux normes de la discussion académique soustraite par définition aux usages finalisés, à une évaluation de compétition dans le cadre du marché académique mondial.
Selon Padis, le classement de Shanghaï n’est vraiment significatif que par la réception démesurée dont il a fait l’objet [1]. Toutefois, en dépit de ses défauts, il révèle un besoin de comparabilité internationale des institutions. Plusieurs projets alternatifs sont en cours dont un programme européen paramétrable par l’usager (U-Multirank). Cela signifie que l’utilisateur a la possibilité de choisir les critères pertinents à son estime, et de disposer des informations utiles par rapport à ses besoins spécifiques.
Dans le cas des revues, la construction des chiffres qui font référence est issue d’une base bibliométrique généraliste et internationale, Science Citation Index (1960) qui au fil des années a donné l’actuel Web of Science après un rachat par Thomson Reuters. Elle a été développée par un entrepreneur, tout d’abord dans les domaines des sciences de la vie et de la chimie parce qu’un marché de l’information rapide existait dans ces secteurs.
Les contraintes de l’information, à une époque où les moyens informatiques n’étaient pas aussi puissants ont conduit à considérer que dans chaque discipline, 10 % des revues recensables regroupaient 90 % de l’information pertinente si elles étaient correctement sélectionnées.
Mais les bases de données furent élaborées au départ pour des disciplines (Sciences de la matière et de la vie) dont les contraintes s’appliquent mal aux sciences humaines où les livres, jusqu’il y a peu, comptaient plus que les articles et où les données sont moins vites périmées.
L’arrivée d’une autre base, Scopus (éditeur Elsevier) laisse espérer que d’autres langues que l’anglais seront prises en considération (entre autres le français et l’espagnol).
Les multinationales actives sur ce marché très lucratif à savoir Elsevier, Springer et Wiley, ont majoré de façon considérable le prix des abonnements universitaires.
Dès lors Marc-Oliver Padis se demande pour quelles raisons ne pas supprimer cette rente de situation en publiant le résultat des chercheurs sur des archives ouvertes en ligne ou un site universitaire de prépublication.
Seule l’évaluation entre pairs (en « double aveugle » à savoir par deux lecteurs sur un texte anonyme) et donc la confrontation avec ses collègues semble en justifier le maintien. L’auteur considère que la position économique des revues de recherche est « fragile » si leur justification ne repose plus que sur la validation entre pairs.
Il semble évident que « … l’évaluation pousse à la spécialisation, puisqu’il faut publier dans des revues repérées comme le centre de la discipline, alors même que la « culture générale » est en crise et que le débat public a besoin de médiateurs capables de lier les sujets entre eux ».
Pour le contributeur, l’université doit « rendre possibles et utiles des usages non savants de la connaissance », ce qui implique une émancipation vis-à -vis des normes d’évaluation spécifiques à la recherche, qui sont balisées par la vérification entre pairs.
Et le Rédacteur en chef de la revue de conclure que l’espace intellectuel de revues généralistes non savantes conserve plus que jamais son sens pour aider à animer un débat démocratique informé et constructif.
Comme on le sait, la revue semestrielle Pyramides du CERAP est en accès libre à l’exception des deux dernières livraisons. Elle s’inscrit donc largement dans un projet de diffusion maximale et s’efforce d’alimenter le débat public via des informations et des éléments d’analyse. Il importe aussi de garder à l’esprit le fait que la revue du CERAP est issue d’un projet mixte associant dès l’origine, académiques et acteurs administratifs. Cela en fait sa force et sa faiblesse, et en tous les cas sa singularité.
Alexandre Piraux.
Recension. L’idée même de richesse
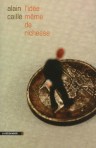
Alain Caillé, Coll. Cahier libres, La Découverte, 2012, 140 p.
Alors que de plus en plus de voix s’élèvent contre la domination idéologique du néo-libéralisme et la généralisation des méthodes du new management dans les différentes sphères de la société, y compris, comme l’écrit Myriam Revault d’Allonnes, dans celles qui touchent à des biens communs irréductibles au calcul économique telles que la justice, l’hôpital, la psychiatrie, la culture ou l’université (Revault d’Allonnes, 2010), Alain Caillé, professeur émerite de sociologie à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, nous entraîne dans une réflexion sur l’idée de richesse. Rappelons qu’Alain Caillé est le fondateur et le directeur de La Revue du MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales) . Ce mouvement s’emploie à dégager depuis une trentaine d’années le “paradigme du don” , dans le sillage notamment de l’Essai sur le don de Marcel Mauss, partant de l’hypothèse qu’on ne parviendra à bien comprendre le sens des questions et des réponses posées et apportées par la philosophie morale ou politique et par les sciences sociales qu’en montrant comment les sociétés, les organistions et les individus sont modelés par la triple obligation de donner, recevoir et rendre.
Constatant l’inquiétude des pays les plus riches, couverts de dettes parce que de plus en plus financiarisés et désindustrialisés – à l’exception notable de l’Allemagne- de basculer dans la pauvreté, l’auteur relève que les débats politiques se circonscrivent sur la manière de retrouver un minimum de croissance. Cela n’est guère étonnant, explique-t-il, puisque le contrat social tacite qui cimente l’adhésion aux valeurs démocratiques repose sur la perspective d’un enrichissement constant partagé par tous. Dès lors, ce sont tous ces liens sociaux patiemment tissés au fil des générations qui menacent aujourd’hui de se détricoter brusquemement et violemment. La crainte d’un tel péril, souligne Caillé, fait passer au second plan un danger bien plus grave encore : celui de la rupture définitive de tous les équilibres écologiques qui assuraient la survie de la planète. Alors que pour des raisons écologiques, il nous faudrait apprendre à vivre de la manière la plus heureuse possible avec une croissance continûment faible, la crainte de catastrophes politiques qui guettent nos sociétés de croissance désormais sans croissance nous pousse à tout faire pour la relancer. Il convient dès lors de se demander comment sortir de cette injonction paradoxale.
A cette fin, Alain Caillé nous invite à nous pencher sur ce qu’est la richesse. Il rappelle l’identification opérée dans les années 70 par le prix nobel d’économie, Jan Tinbergen, entre le produit national brut (PNB) et le bonheur national brut (BNP) et les critiques qui se sont élevées par rapport à une telle approche. Le souci d’adopter une autre convention de richesse qui prenne en compte tout ce qui contribue à l’accroissement de l’utilité sociale et qui retranche ce qui diminue celle-ci a amené à élaborer de nouveaux indicateurs de richesse. Il s’agit pour les initiateurs de ceux-ci d’appréhender une richesse qui ne serait pas seulement économique, monétaire ou marchande mais également sociale et environnementale. L’ancêtre des indicateurs de richesse alternatifs est l’indicateur de développement humain (IDH), dû aux économistes pakistanais Mahhub ul Haq et indien – futur prix nobel d’économie - Amartya Sen, qui apparut pour la première fois en mai 1990 dans le premier Rapport mondial sur le développement humain publié par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Sur base de cet indicateur, les pays étaient classés à la fois en fonction de l’état de santé, du niveau d’instruction et du pouvoir d’achat de leurs habitants. L’IDH a suscité nombre d’émules : ceux qui prennent en considération la dimension environnementale (par exemple, l’empreinte écologique, le PNB vert ou les indicateurs de développement durable élaborés par l’Union européenne), ceux qui se focalisent plutôt sur la dimension sociale, sur les inégalités, notamment hommes/femmes, sur la justice, l’éducation, la santé, la sécurité sociale…, ceux qui tentent d’évaluer le bonheur, la qualité de vie (par exemple, l’indice du bonheur national brut du Bouthan, l’indice candien du mieux-être) et les indicateurs synthétiques qui proposent des pondérations variables entre ces trois dimensions (par exemple, l’IDH ajusté ou la mesure de l’épargne nette ajustée proposée par Joseph Stiglitz et Amartya Sen au président de la République française). Ce type de voie, estime Alain Caillé, permet de desserrer le carcan de l’imaginaire marchand et financier et de cantonner les préoccupations économiques dans leur domaine d’élection, à savoir, le seul ordre économique dont elles n’auraient pas dû sortir. Mais il y a également un danger à vouloir tout mesurer : assurer le triomphe d’un impératif de quantification générale, d’une quantophrénie qui ne limiterait le poids des évaluations marchandes que pour mieux universaliser des normes quasi marchandes. Avec le risque, poursuit l’auteur, que disparaisse alors tout ce qui subsiste encore de l’ordre de la gratuité et de l’inestimable.
Or, comme le révèle la sociologie du travail et des organisations, celui-ci est primordial pour le bon fonctionnement des organisations. Alain Caillé note que, depuis l’enquête d’Elton Mayo en 1929-1932 aux ateliers Hawthorne de la Western Electric près de Chicago et la fondation de l’Ecole des relations industrielles, sociologues, psychosociologues, économistes du travail et gourous en management “passent leur temps à redécouvrir toujours la même chose” : la clé de l’efficacité et de la réussite réside moins dans la qualité de la structure formelle de l’entreprise, de son organigramme officiel que dans la structure informelle, non visible de l’entreprise, dans l’ensemble des relations de personne à personne. Les analyses de Norbert Alter permettront de faire apparaître ce qu’il y a dans cette boîte noire. Elles établissent en effet qu’au coeur de la structure informelle de l’organisation et des relations de personne à personne, comme à la racine de la mobilisation au profit des objectifs de l’organisation, on trouve l’esprit du don. Plus précisément, comme Alter le rappelle, la triple obligation de donner, recevoir et rendre mise en lumière par Marcel Mauss se structure selon deux dimensions, l’une horizontale, l’autre verticale. Horizontalement, on trouve l’ensemble des relations de don et contre-don entre collègues, l’échange des savoir-faire, des petites informations pratiques, des soutiens psychologiques… Verticalement, on relève la capacité à se mobiliser pour l’organisation que ce soit par plaisir, devoir ou intérêt. On parlera ici, plutôt que de don, d’adonnement.
Alain Caillé considère, qu’une fois ces considérations posées, on se trouve mieux armé pour jeter un regard critique sur le néomanagement qui règne désormais en maître dans les entreprises, les administrations, les mutuelles ou les grandes associations. Or, à ses yeux, le néomanagement présente trois défauts majeurs. Il pointe, en premier lieu, la mise en concurrence de tous avec tous. Une telle gestion par le stress engendre un climat de tension qui conduit à la détestation du travail et se révèle potentiellement suicidogène [1]. L’auteur met ensuite en cause la quantophrénie généralisée – c’est-à -dire la tentation de réduire la totalité de l’activité en données quantifiables - qui engendre un sentiment – et souvent une réalité - d’absurdité parfaite, les indicateurs retenus étant en effet le plus souvent extraordinairement arbitraires [2]. Enfin, Alain Caillé relève que la subordination du travail à son évaluation quantifiée tend à donner systématiquement le privilège aux motivations extrinsèques – indifférentes à la nature particulière de l’action - sur les motivations intrinsèques - inhérentes à l’action même. Alain Caillé fait remarquer que les administrations, les mutuelles ou les grandes associations qui devraient, en conformité avec leurs idéaux, appliquer d’autres règles de fonctionnement, se montrent au contraire les plus zélées dans la mise en oeuvre de la nouvelle doxa gestionnaire, avec dix ou vingt ans de retard sur le secteur concurrentiel. Cela, alors que certaines grandes entreprises découvrent ou redécouvrent qu’aucune action collective organisée ne peut fonctionner sans faire sa place à l’esprit du don.
Soulignant le danger d’une généralisation de la mesure évaluative, Alain Caillé offre la parole à la défense de celle-ci, laquelle est assurée de façon très subtile par le sociologue François Vatin [3]. Un tel échange nourrit la réflexion sur le rapport entre réalité et monde (cf. Boltanski, 2009) ou chaos et cosmos (cf. Castoriadis, 1986) [4]. Car, François Vatin l’admet, la mesure est réductrice et cela est sa fonction même. Mais il n’entend pas pour autant y renoncer. Pour s’orienter dans le monde, estime-t-il, des points d’appui sont nécessaires. Confrontée au réel, la mesure montrera elle-même ses limites, appellera à son renversement paradigmatique, quand d’autres mesures plus fines seront disponibles. Pour François Vatin, la mesure, loin de nous occulter le caractère fondamentalement incertain du monde, nous le rappelle et nous fait prendre pleinement conscience des limites de notre maîtrise. Elle n’est pas le reflet fidèle d’un monde fixe, elle est un guide fragile dans un univers indéterminé. Rappelant l’opposition entre la conception platonicienne utilitariste de la cité et de la justice, fondée sur un idéal de mensuration et l’approche aristotélicienne anti-utilitariste qui se refuse à la quantification de nos actes et du rapport social, Alain Caillé ne cache pas sa préférence pour la seconde, sans en méconnaître les tares possibles. Car, le modèle utilitariste lui paraît porteur de risques bien plus considérables, le premier de ceux-ci étant de déboucher sur une instrumentalisation généralisée de l’existence humaine en rapportant l’infinie diversité des motivations à la seule question « à quoi ça sert ? ». Pour Caillé, ce n’est pas l’introduction de la mesure en elle-même qui est problématique, mais deux choses assez étroitement liées : le fantasme de la bonne mesure unique et la liquidation de l’autonomie relative des corps professionnels qu’il favorise.
Observant les multiples expériences et courants de pensée ainsi que les divers mouvements récents d’émancipation (printemps arabe, indignés…) à travers lesquels un monde post-néolibéral cherche à s’inventer, Alain Caillé pense que ceux-ci ne seront à la hauteur des défis colossaux que nous devons affronter que s’ils prennent conscience de leur unité potentielle. Il envisage une telle convergence sous la bannière du convivialisme, faisant écho aux analyses d’Ivan Illich (Caillé, Humbert, Latouche, Viveret, 2011). Ce convivialisme doit assumer sa dimension d’idéologie politique de notre temps, qui synthétise et dépasse les quatre grandes idéologies de la modernité que sont le libéralisme, le socialisme, l’anarchisme et le communisme. Ces quatre idéologies présupposent en effet, explique Caillé, que seule une croissance économique infinie est susceptible de désamorcer le conflit entre les hommes et les peuples et d’apporter le progrès. Une politique convivialiste devrait s’orienter progressivement, à un rythme variable selon les régions du globe, vers un état économique stationnaire dynamique, c’est-à -dire quantitativement et mathématiquement stable mais qualitativement évolutif parce que systématiquement orienté vers le progrès social, éthique et culturel. Un tel projet suppose trois conditions principales. D’abord, il faut mener une lutte délibérée contre la démesure, source de toutes les corruptions, qui passe par la mise hors la loi de l’extrême richesse comme de l’extrême pauvreté par l’instauration conjointe d’un revenu maximum et d’un revenu minimum et par la mise hors jeu de la finance spéculative. L’actuelle crise financière a mis de telles préoccupations à l’agenda des décideurs politiques. Par exemple, en Belgique, le ministre fédéral des entreprises publiques, Paul Magnette, a annoncé d’emblée son intention de limiter les salaires des « top managers » des entreprises publiques [5]. Ensuite, il s’agit de redéfinir les Etats-nations dans une perspective transnationale et transculturelle qui prenne comme principe régulateur l’objectif de favoriser le maximum de pluralisme culturel qui soit compatible avec leur maintien. C’est la question de la communauté politique qui est ici traitée. On notera qu’à l’inverse d’autres intellectuels (par exemple, Toni Negri), Alain Caillé pense que l’Etat-nation « reste et restera longtemps la forme principale de la communauté politique, l’incarnation par excellence de la liberté collective et de la solidarité » (Caillé, Humbert, Latouche, Viveret, 2011). Enfin, la société civile associationniste, qu’elle soit locale, régionale, nationale ou transnationale, devra conquérir sa peine autonomie et sa souveraineté politique. Car, précise Caillé, si le libéralisme et le socialisme ont été les champions respectivement du marché et de l’Etat, le convivialisme parle au nom de la société elle-même, telle que représentée, mise en forme et en actes par l’efflorescence des associations. Ce point du programme convivialiste est porteur de controverse sur le plan de la démocratie. Ainsi, le politologue Guy Hermet ne cache pas son scepticisme quant au concept de « société civile » qu’il identifie comme « d’un côté la prééminence d’une citoyenneté activiste mais désordonnée de « démocrates immatures » [6], de l’autre la domination d’une classe plus managériale qu’associative agissant en productrice intéressée de la bonne pensée » (Hermet, 2007).
L’approche anti-utilitariste d’Alain Caillé nous apporte un éclairage précieux dans la critique des modes de gestion imposés actuellement aux services publics ainsi qu’aux grandes associations et entreprises de l’économie sociale. Mais, au-delà , c’est, selon les termes de l’auteur, la voie d’un messianisme proprement politique qui nous est proposée. Le convivialisme, que l’on pourra découvrir de façon plus approfondie dans l’ouvrage collectif « de la convivialité - dialogues sur la société conviviale à venir » (Caillé, Humbert, Latouche, Viveret, 2011), se présente en effet comme l’idéologie la plus apte à concilier la préservation de la démocratie avec la capacité de mettre en œuvre des solutions aux problèmes graves qui menacent aujourd’hui l’humanité. Mais elle n’a, pour Alain Caillé, de chance de s’imposer, que si des « millions, des dizaines ou des centaines de millions d’hommes et de femmes se convainquent qu’elle est notre seule issue désirable possible et s’ils déploient pour l’imposer une ferveur démocratique quasi religieuse ». La détermination n’exclut cependant pas la lucidité devant la difficulté éprouvée par les multiples luttes, expériences, théorisations qui se font jour partout à travers la planète pour converger de façon à pouvoir peser de manière effective sur le cours du monde. En témoigne ce sentiment que le déclencheur du messianisme politique évoqué sera très probablement la conjonction d’un désastre, économique, social ou écologique et d’un sentiment d’indignation irrépressible.
Bibliographie
Alter, N., Donner et prendre. La coopération en entreprise, Paris, La Découverte/MAUSS, 2009.
Boltanski, L., De la critique. Précis de sociologie de lémancipation, Paris, Gallimard, 2009.
Caillé, A., Humbert, M., Latouche, S., Viveret, P., de la convivialité dialogues sur la société conviviale à venir, Paris, La Découverte, 2011.
Caillé, A., L’idée même de richesse, Paris, La Découverte, 2012.
Castoriadis, C., Les carrefours du Labyrinthe, II. Domaines de l’homme, Paris, Seuil, 1986.
Hermet, G., L’hiver de la démocratie ou le nouveau régime, Paris, Armand Colin, 2007.
Revault d’Allonnes, M., Pourquoi nous n’aimons pas la démocratie, Paris, Seuil, 2010.
Stoker, G., « Immature democrats », Prospects, janvier 2006.
Jean-Paul Nassaux
Gouvernement & action publique
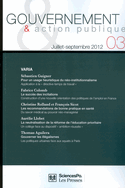
La nouvelle revue française Gouvernement & action publique diffusée depuis début 2012 s’intéresse aux activités de gouvernement au sens large : les transformations des Etats, des exécutifs et des administrations, les formes multiples d’organisation et de fonctionnement des gouvernements et la conduite de l’action publique.
Gouvernement & action publique est une nouvelle revue académique qui pense que les enjeux de gouvernement méritent d’être au centre d’un projet éditorial académique, gouvernement étant entendu au sens large de government ce qui inclut les administrations, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif ainsi que de nombreuses autorités européennes, communales, parapubliques. Le champ d’analyse et d’études est donc aussi vaste que celui de Pyramides.
La jeune revue est également très centrée sur la volonté de faire tenir ensemble des approches disciplinaires aujourd’hui très autonomisées : sociologie de l’Etat, science administrative, analyse des politiques publiques, gestion publique, politique comparée, études européennes, sociohistoire des institutions etc…
Gouvernement & action publique est édité par les presses de Sciences Po et est également disponible sur le Cairn (tout comme Pyramides). La revue trimestrielle principalement ancrée en science politique conjugue des numéros spéciaux (thématiques) à des varia.
Le premier numéro (janvier-mars 2012) est dédié aux décloisonnements, au dépassement de frontière entre objets et disciplines. L’article de Philippe Bezes et de Frédéric Pierru paru dans le numéro 02, Etat, administration et politiques publiques : les dé-liaisons dangereuses est à cet égard paradigmatique.
Dans le varia du numéro 02 (avril-juin 2012), Christophe Dubois et Jean-François Orianne sociologues à l’ULG traitent de l’introduction de la justice réparatrice dans les prisons belges dans Les politiques publiques comme partitions à construire.
Philippe Bezes (CERSA/CNRS/Paris -2) et Patrick Hassenteufel (CESDIP/Université de Versailles-Saint-Quentin) exercent la fonction de rédacteur en chef.
Le numéro 03 (juillet-septembre 2012) est un Varia. Le premier article de ce Varia discute de la portée et de la complémentarité des approches néo-institutionnalistes pour analyser l’intégration européenne à partir du cas de la « directive temps de travail ».
Les deux suivants éclairent sur deux instruments du tournant « néo-libéral » et « néo-managérial des politiques publiques françaises, la prime pour l’emploi et les recommandations de bonnes pratiques en santé.
Le quatrième révèle les limites de la mise en oeuvre d’un nouveau dispositif éducatif, le plan « ambition-réussite », en se basant sur l’expérience d’un collège.
Le dernier article montre comment la mairie de Paris régule et gouverne les squats qui se sont multipliés dans la capitale.
Nous nous réjouissons de cette arrivée et souhaitions longue vie à cette nouvelle revue !
Fonction publique, se moderniser sans se perdre

La revue Politique a consacré un dossier de 25 pages, dans son numéro de janvier-février 2013, au thème de la fonction publique, plus précisément à la situation des fonctionnaires dont le métier et les méthodes de travail ont été profondément modifiés au fil des réformes. Comme l’indique le sous-titre de ce thème, « les nouveaux habits d’un corps mal aimé », les nombreuses mutations de l’administration publique n’ont pas modifié la perception négative que la population éprouve à l’égard des agents. Le statut du fonctionnaire nommé à vie reste un privilège mal compris, beaucoup envié et d’autant plus décrié en période de crise. Dès lors, ce numéro de Politique nous invite à prendre de la hauteur, soit historique, soit philosophique, afin de saisir dans sa complexité le concept de fonction publique. Il donne également la parole à des fonctionnaires confrontés de l’intérieur à la modernisation de leur administration. Non sans difficulté…
Parmi les auteurs qui ont participé à ce dossier, Jean-Paul Nassaux attire l’attention, dans son article « Gouvernance : un bien ou un mal ? », sur la face sombre de la gouvernance, dont les objectifs de rentabilité tendraient à imposer une pensée strictement comptable pour laquelle la démocratie représenterait davantage une contrainte que le fondement de l’action de la fonction publique. Face au consensus généralisé pour une gestion capitaliste de l’administration publique, l’auteur rappelle, tout en déplorant la faiblesse de leur influence dans la sphère politique, les mises en garde émises par certains intellectuels. La gouvernance risquerait de nous mener vers un Etat minimal, appauvri et peu ouvert à la démocratie.
De son côté, Alexandre Piraux (« Vers des réformes de 3e génération ? ») relève l’existence de modèles alternatifs de réformes, postconcurrentiels car axés sur les valeurs de la fonction publique et des défis plus sociétaux, sans que ces modèles ignorent les contraintes financières, mais en tenant compte de leur contexte politique. Ainsi, bien que ces modèles soient encore inachevés et peu suivis, ils se démarquent du New Public Management qui inspire les administrations depuis les années 80’, en prenant le secteur privé comme modèle de gestion. Pour Alexandre Piraux, il est encore difficile de dire si ces modèles de 3e génération sont réellement nouveaux ou simplement correcteurs des actions du passé. L’optimisme n’est en tout cas pas de mise : « On a la pénible impression que les gouvernements considèrent leur administration (…) comme un problème et non plus comme une partie de la solution ».
Politique s’est entretenu avec le Professeur Jean Jacqmain autour de la question du statut privilégié des fonctionnaires. Face aux critiques à l’égard des avantages dont bénéficient les agents de la fonction publique, il estime que c’est la situation des fonctionnaires qui doit être davantage regardée comme normale, par rapport à la situation du droit du travail (conditions de travail précaires) qui est devenue anormale. Il revient sur les raisons des privilèges dans l’administration, l’importance de la mission de continuité du service public et le besoin de sérénité dans les rapports avec la classe politique. L’introduction du système de mandat dans la haute fonction publique est par exemple, pour l’interviewé, en contradiction avec l’esprit de service public : « L’introduction du management, lié au mandat, est en tout cas un facteur de pourrissement en terme de motivation du personnel car le fait que la direction de l’administration soit placée dans une situation d’instabilité est assez néfaste ».
Kenneth Bertrams, historien à l’Université Libre de Bruxelles, revient sur la genèse de la fonction publique, en particulier en Belgique où elle naît juridiquement dans un contexte politique tendu. Par une plongée dans l’histoire, l’auteur mentionne les racines technocratiques de l’administration.
Philippe Meunier, fonctionnaire fédéral depuis 30 ans, porte quant à lui un regard critique sur la réforme Copernic. Le bilan de la réforme peut dépendre fortement de la conception que le/la ministre a de sa relation avec son administration. Philippe Meunier relève l’impact faible de la réforme sur la société et surtout, la culture de méfiance qui prédomine de la part de tous les acteurs à l’égard des autres. L’auteur s’interroge : « pourquoi s’intéresser si peu à la manière dont les services publics fonctionnent ? ».
Dans un second article, « Selor : qualité en hausse », Philippe Meunier dresse un bilan plutôt positif pour la sélection des fonctionnaires dirigeants : la qualité des lauréats s’est améliorée. Toutefois, la politique de compression des effectifs dans la fonction publique fédérale, couplée à l’importance du diplôme comme critère d’engagement par l’Etat, cette situation accentuera à l’avenir, d’après l’auteur, la discrimination sociale à l’embauche.
Un dernier volet du dossier de la revue se penche sur les administrations régionales (bruxelloise et wallonne) qui ont connu leur train de réformes propre, en particulier au sein du personnel. A Bruxelles, Gratia Pungu considère que la contractualisation a créé une forme de discrimination car elle a touché en priorité les nouveaux venus, au sein des pouvoirs locaux. D’autre part, au sein de l’administration régionale bruxelloise, l’auteure relève que les différences statutaires au sein du personnel et l’évaluation individualisée détruisent la solidarité des travailleurs.
Côté wallon, Luc Melotte, ex-directeur général Personnel et Affaires générales, désapprouve le partage des compétences au niveau politique, qui complique les liens avec les fonctionnaires, un mandataire pouvant dépendre de 2 à 7 ministres différents. La réorganisation de l’administration wallonne a été marquée par une accélération du phénomène d’agencification , mal ressentie au niveau de l’administration centrale qui perd des moyens et ses meilleurs éléments, attirés par des opportunités de carrière plus avantageuses en agence.
De ce fait, l’inégalité statutaire entre fonctionnaires, au niveau fédéral ou régional, crée des tensions entre les travailleurs et est très éloignée des valeurs (égalité, continuité du service public,…) que la fonction publique est sensée refléter.
En conclusion, ce numéro stimulant de Politique présente des visions personnelles, variées et parfois même contradictoires des services publics face à la modernisation.
Comme l’affirmait Baudelaire, « la modernité, c’est le fugitif, le transitoire, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable ».
Florence Daury
* * *
« Fonction publique : se moderniser sans se perdre – Les nouveaux habits d’un corps mal aimé » (dossier de 25 pages), Politique, n°78, janvier-février 2013. (9 euros)
The Wage under Attack. Employment Policies in Europe

Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2013, 293 pp.
Challenging the widespread view of the continental model of social protection as a « corporatist-conservative » system, this book stresses the creative thrust of the two major institutions of the Bismarckian tradition : the social contribution that finances the socialised wage, and the qualification system that liberates workers from the labour market. These institutions have come under attack over the past two decades via European Employment Strategy policies aimed at imposing the Beveridgean model. And the European Union is using the current economic crisis to justify stepping up this reform process. The conceptual framework proposed in this volume provides the basis for a critical examination of the interrelated developments in European integration and national policies on employment and social protection. As well as contributing to a sociology of monetary resources, it highlights the emancipatory potential of the continental tradition of the socialised wage, and demonstrates the negative implications of the European Union-led reforms.
Les règles d’or du lobbying

Le livre de Stéphane Desselas et Natacha Clarac, « Les règles d’or du lobbying » se présente essentiellement comme un outil méthodologique qui décrit en détail toutes les étapes clé du processus d’influence et prodigue les conseils utiles pour tisser intelligemment son réseau parmi tous les acteurs qui jouent un rôle au sein et dans la périphérie des institutions européennes. Même si la lecture de l’ouvrage peut être utile aux professionnels, il s’adresse plutôt aux novices qui désirent comprendre les rouages de la profession avant d’entreprendre une action de lobbying. Les auteurs expriment le vœu que le lobbying se démocratise. Ils déclarent que « la démocratisation du lobbying offrira aux décideurs publics la possibilité d’avoir accès à une plus grande variété de points de vue pour leur permettre de définir l’intérêt général en toute connaissance de cause ».
Tout comme il est légitime de douter que le lobbying constitue une pratique favorable à l’intérêt général, nous pensons qu’il est également nécessaire d’écouter ceux qui pensent que « le lobby contribue à la démocratie en apportant de l’information essentielle aux responsables publics » (Les coulisses de l’influence en démocratie, Marie-Laure Daridan et Aristide Luneau).
En guise d’illustration, l’ouvrage comporte un chapitre constitué de témoignages de représentants de grandes entreprises qui expriment leur point de vue sur le métier de façon très instructive.
Pour compléter les informations que « les règles d’or du lobbying » fournissent, nous avons interrogé une lobbyiste pour les intérêts économiques d’une région de France, active auprès des institutions européennes :
Serait-il souhaitable de professionnaliser plus strictement le milieu du lobbying pour éviter qu’il y règne un amateurisme nuisible à sa réputation ?
On peut certes améliorer la formation … à condition toutefois qu’il en existe une. Les écoles de lobbying sont récentes et peu nombreuses. Le lobbying dépend également beaucoup de la culture de celui qui le pratique. Pour aller dans le sens des idées reçues, les anglais le pratique de façon très différente des français, par exemple. Le procédé est beaucoup mieux accepté et reconnu dans les pays anglo-saxons qui en ont une longue tradition. Dans les pays du sud de l’Europe, on confond souvent le lobbying avec le clientélisme et les « dessous de table », la corruption. Le problème n’est ni le lobbying ni la corruption. Il faut simplement punir les agissements contraires aux lois. Le lobbying transparent est généralement celui pratiqué auprès des institutions de l’Union européenne.
Les décideurs sont sur-sollicités par les lobbyistes, d’après l’ouvrage. Comment ressentez-vous cela dans votre pratique ?
Pour aller à l’encontre de cette affirmation, on peut dire que les décideurs sont également demandeurs. Les lobbys leur fournissent un grand nombre d’informations en provenance du terrain car ils sont souvent très connaisseurs sur des sujets précis et servent de relais de transmission
L’ouvrage conseille aux lobbyistes de traduire leurs objectifs dans une structure la plus proche possible d’un amendement. Voit-on dès lors les décideurs reprendre tels quels les amendements proposés par les lobbyistes ?
Oui, il arrive que nos propositions d’amendement soient reprises tels quels par les fonctionnaires européens mais c’est alors l’aboutissement d’un travail de plusieurs mois, basé sur des dossiers complets, des études. Un parlementaire accepte de prendre à son compte un amendement tel quel, que si la rédaction lui convient et surtout, s’il a été convaincu par l’argumentaire qui l’accompagne. Cela prend beaucoup de temps. Je n’ai jamais vu un fonctionnaire accepter de suite une proposition d’un lobbyiste et le lobbyiste n’approche pas le fonctionnaire avec un amendement tout prêt en main. Les relations entre fonctionnaires et lobbyistes sont très consciencieuses, très prudentes car il en va de leur réputation respective. De plus, le parlementaire n’est pas lobbyé par un seul cabinet, les autres lobbys font également valoir leur point de vue et il décide seul.
Le projet de règlement de la Commission sur la protection des données privées et les fortes pressions des lobbyistes dans ce dossier semble illustrer que le travail de lobbying consiste parfois à vider de leur substance le travail règlementaire ?
Encore une fois, le travail du lobbyiste n’est pas de défaire ce que fait le politique mais de l’aider à le faire mieux ou du moins, en tenant compte des intérêts en présence. L’intérêt de l’Etat, qui est parfois soumis à de très fortes pressions, n’est pas toujours l’intérêt du plus grand nombre. Là où l’on pourrait se poser des questions, c’est comment les Etats ont laissé à certaines entreprises, comme dans le secteur du tabac, un pouvoir énorme et une capacité d’influence qui les dépassent complètement.
Ne faut-il pas une régulation du lobbying par secteur (santé publique, énergie, nucléaire) ?
Une sectorisation serait difficile à mettre en place, tout simplement parce que plusieurs secteurs se chevauchent. D’autre part, quand on parle de lobbying, on pense surtout aux entreprises privées alors que de nombreux groupes d’influence représentent des intérêts régionaux, des organismes publics, si bien que le lobbyiste se trouve parfois des deux côtés de la barrière, du côté des fonctionnaires et du côté des lobbyistes. Par exemple, en tant que représentant des intérêts d’une région française, c’est parfois Paris qui nous appelle au secours car il ne sait pas comment se défendre sur le plan juridique auprès de la Commission. Dans ces cas-là , nous ne représentons plus notre groupe d’intérêts en particulier mais l’Etat français tout entier.
Florence Daury
Vingt ans de politique portuaire à Bruxelles (1993 - 2012). I. Le contexte et les prémices

Recension par Florence Daury et Alexandre Piraux
Ce numéro du Courrier hebdomadaire du CRISP analyse les spécificités du Port de Bruxelles, port intérieur d’une grande ville en phase de tertiarisation, à la lumière des contrats de gestion conclus entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Port.
Parmi les nombreuses informations à retenir de ce texte dense, commençons par le beau voyage dans l’histoire économique, urbanistique et sociale de Bruxelles et son espace portuaire, que nous offre l’auteure, Geneviève Origer.
Depuis la naissance de Bruxelles dans la vallée de la Senne, rivière difficilement navigable, l’embryon de port dès l’an mil, les efforts du Duc de Bourgogne Philippe Le Bon en faveur du développement du Port, et la création en 1896 de la Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles, les multiples plans de modernisation de la place portuaire bruxelloise se sont succédé au fil des siècles et ont façonné Bruxelles et sa région.
Un contexte métropolitain et globalisé
Pour toute ville portuaire, l’enjeu essentiel de notre époque est de faire coïncider le développement urbanistique avec sa fonction logistique. Comme nous l’explique Geneviève Origer, les villes ont profondément changé vers un modèle « postindustriel » qui désigne tout à la fois la fermeture des usines (l’apparition de friches urbaines), la diminution de la valeur de la production industrielle dans l’évaluation de la richesse collective (désindustrialisation) et la baisse des effectifs ouvriers. Dans ce cadre est apparu le « modèle Dubaï » du tourisme, soit un « rapport touristique au monde, un rapport transparent à un monde divertissant et déréalisé » (Mike Davis, Le stade Dubaï du capitalisme), ce qui complique le maintien des industries au sein des villes. Bruxelles s’est notamment inscrite dans ce mouvement avec l’organisation d’évènements tels que Bruxelles-les-Bains ou encore, Plaisirs d’Hiver.
D’autre part, le phénomène de métropolisation à l’œuvre découpe l’espace en une mosaïque de territoires où la délibération politique s’intensifie. Les limites de l’espace urbain lui-même deviennent floues, les chaînes logistiques se diversifient, le transport routier domine, tout comme les logiques foncières, les entrepôts se dispersent : tels sont quelques effets de ce phénomène.
Comme l’explique l’auteure, avec l’éloignement des terminaux, la « désurbanisation » des installations portuaires, les ports sont devenus des territoires inconnus pour les citoyens. Le secteur industriel et portuaire offre une image considérée comme dépassée et déclinante qui cadre peu avec les aspirations de métropoles tertiaires et modernes.
Dans toute l’Europe, le transport de marchandises est alors peu apprécié des mandataires politiques qui en perçoivent rarement l’aspect complexe et innovant. Aucune métropole ne peut pourtant se passer du secteur des marchandises qui est un secteur structurant et qui permet de maintenir des emplois à faible qualification, peut-on encore lire. Geneviève Origer estime que « le déclassement des anciens espaces portuaires ne devrait pas être trop précipité car la potentialité première de ces espaces est d’être un cadre propice au développement d’activités portuaires. Certaines villes ont pris conscience qu’en rejetant leur caractère portuaire, elles se privaient de l’un de leurs fondements, de leur source d’identité, d’attractivité et de développement ». L’auteure cite également Bruno Guillermin pour qui « le constat de l’importance croissante des échanges internationaux dans l’économie des métropoles conduit à considérer le port comme un maillon essentiel d’une stratégie de développement et donc à prévoir l’adaptation de l’outil portuaire plutôt que sa suppression ».
Quelques chiffres
Le Port de Bruxelles peut se raconter en chiffres. Comme ils abondent dans ce numéro du Courrier, nous choisissons d’en citer quelques-uns, parmi les plus représentatifs : le Port est situé à 120 km de la mer, au carrefour de plusieurs autoroutes européennes, en connexion avec un réseau ferroviaire important et proche du réseau aérien. La voie d’eau traverse la région bruxelloise du sud-ouest au nord-est, sur une longueur de 14 km. Vers le sud, la voie d’eau met en liaison Bruxelles avec le Hainaut et la France ; elle devrait être reliée au bassin parisien, si le canal Seine-Nord est réalisé par la France. Ce projet, actuellement à l’arrêt, incarne le désir d’une politique de transport multimodal du fret qui limiterait l’importance du trafic routier. Il pourrait ressurgir car le dossier devrait être soumis dans le courant de l’année 2014 à la Commission européenne, afin de lever des fonds européens pour le chantier.
Bruxelles dispose d’un domaine portuaire de 85 hectares de surface utile et est équipé de 5,6 km de quais, dont 2,8 km de quais maritimes. 24 millions de tonnes de marchandise sont acheminées chaque année sur la voie d’eau et le domaine du port, dont plus de 7 millions par voie d’eau.
Par ailleurs, le port assure l’approvisionnement de la métropole en matériaux de construction et en produits énergétiques, et l’évacuation des résidus de la consommation urbaine. Les 360 entreprises installées sur les sites portuaires procurent près de 6000 emplois directs (12 000 avec les emplois indirects), et particulièrement plus de la moitié d’emplois peu qualifiés. En 2008, la valeur ajoutée directe produite par les entreprises portuaires bruxelloises était de 680 millions d’euros.
Jusque dans les années 50, Bruxelles était la première ville industrielle du pays mais la désindustrialisation rapide, les mutations urbanistiques et institutionnelles ont remis en question le rôle de la place portuaire. Le transport par voie d’eau, dans la section localisée à Bruxelles, s’est dégradé, notamment avec la délocalisation d’entrepôts pétroliers et le départ de la dernière cokerie bruxelloise.
Un foncier coûteux et la localisation centrale urbaine du port sont des handicaps qui complexifient l’extension de l’espace et freinent l’arrivée de nouvelles entreprises portuaires. De plus, l’activité portuaire, avec ses nuisances, est mal considérée par ses riverains et des associations de défense de l’environnement. D’autres critiques se sont fait entendre par rapport aux difficultés de financement de la Région de Bruxelles-Capitale, non sans raison signale l’auteure.
La réputation de la place portuaire auprès des entreprises et investisseurs potentiels souffre aussi de l’échec de plusieurs projets de développement ou de leur report, ce qui crée une insécurité juridique.
La région bruxelloise ne représente qu’un espace de 161 km². Dans un contexte concurrentiel très vif, la comparaison est difficile à tenir pour Bruxelles, face à deux autres régions qui soutiennent l’implantation d’activités logistiques dans le Brabant wallon et le Brabant flamand.
Le statut du Port de Bruxelles
Le Port de Bruxelles est une personne morale de droit public soumise à la loi du 16 mars 1954 relative à certains organismes d’intérêt public. Il s’agit d’un organisme para-régional de type B soumis à la tutelle du gouvernement bruxellois. Il revêt la forme d’une société anonyme de droit public dont la Région (58,05%), la Ville de Bruxelles (33,40%), huit communes bruxelloises (4,88%) et la SA BRINFIN de conseil en gestion financière du groupe SRIB (3,67%) sont actionnaires.
L’auteure examine ensuite les organes de fonctionnement du Port, ses modes de financement (entre autres, outre les recettes propres, les emprunts, les prêts de la Banque Européenne d’Investissement, puis les partenariats avec le secteur privé, cf. infra) et la manière dont son cahier des charges définit les missions de service public.
Dans le cadre étroit de notre analyse, nous allons nous limiter aux obligations de service public, faute de place.
Les missions du Port contiennent deux volets, le premier intitulé « d’intérêt général » a trait à l’infrastructure (au sens large), au respect de la législation et de la gestion financière. Le second, dénommé « missions spécifiques » concerne les relations avec les usagers du Port (les entreprises) et le développement du patrimoine. Comme le mentionne l’auteure, on retrouve ici en filigrane, les notions de services d’intérêt général et services d’intérêt économique général qui sont définies par la Commission européenne (article 106 du TFUE).
Comme les besoins en investissements du Port sont importants des filiales ont été créées et des partenariats avec le secteur privé conclus (PPP).
Contrairement à ce qui a prévalu dans d’autres organismes, une évaluation du contrat de gestion en fin d’exercice a toujours été menée au Port de Bruxelles.
Les préliminaires de la société régionale
En 1987, le mandat de la Société anonyme du canal (ou Société du Canal) est reconduit mais la régionalisation des ports et voies d’eau est annoncée. La société du Canal se trouve à cette époque dans des difficultés financières et doit moderniser son fonctionnement. Au même moment, une « poussée immobilière brutale s’exerce sur le foncier du port en cette fin des années 1980 ». Une menace immobilière pèse sur les activités portuaires jugées peu « nobles ». Une multitude d’études sont consacrées à la problématique portuaire bruxelloise. Une en particulier, semble viser la construction de bureaux et de logements de luxe. Elle suscite la colère de la Communauté portuaire qui rappelle que le canal ne doit pas perdre son caractère industriel pour devenir un lieu d’agrément urbanistique voire un ghetto de riches.
Les entrepôts bruxellois du Port sont aussi en position précaire après la désaffectation de l’entrepôt B du site de Tour & Taxis. En 1993, la saga de Musicity va illustrer la tension entre le projet de pôle culturel et la volonté de maintenir et de développer une fonction économique.
Finalement, le Plan régional de Développement (PRD) arrêté par le gouvernement régional en 1995 va rencontrer les arguments des usagers et des entreprises. Un nouvel « élan institutionnel » est de la sorte donné au port de Bruxelles.
La partie I. du Courrier hebdomadaire revient sur la dissolution de la Société du Canal fondée en 1897, la création du nouveau port de Bruxelles et la préparation du premier contrat de gestion.
La prolongation ne sera pas obtenue sans débats car tous les actionnaires ne sont pas convaincus de la nécessité du développement d’un port à Bruxelles. Une prolongation de trente ans est quand même décidée vu qu’il serait dangereux, selon un rapport administratif « de voir se développer en aval un port concurrentiel ».
L’entrée en vigueur des nouveaux statuts permet de trouver un équilibre sur le plan communautaire. Six communes flamandes s’ajoutent dans l’actionnariat de la société.
La régionalisation de la Société anonyme du Canal
Début 1989, la Société du Canal se dote d’une commission de restructuration, composée d’administrateurs bruxellois et de l’inspecteur des Finances afin de préparer les structures de la nouvelle société issue de la régionalisation. Mais la situation financière est compliquée et les pertes s’accumulent d’exercice en exercice, en raison d’un engagement de personnel contractuel pour faire face à la régionalisation et dédoubler une partie des services. Des comptabilités séparées en fonction des territoires doivent être dressées. Le projet de dissolution de la Société du Canal fait l’objet d’intenses négociations autour de la répartition du passif. L’actif sera ventilé en fonction de la répartition du passif.
Contrairement à ce que demande le CVP, la forme de la nouvelle société maintient le statut de service public.
La question du contrat de gestion est aussi abordée et il est prévu qu’il n’y aura pas de sanctions financières en cas de non-respect des objectifs fixés par le contrat. Néanmoins, un système de bonus/malus sera appliqué par la suite.
Le numéro se termine sur la préparation du premier contrat de gestion dont la rédaction sera confiée à la société de consultance OGM en avril 1992.
Cette première partie du Courrier hebdomadaire témoigne des intenses débats portant sur les objectifs d’intégration urbaine du Port versus sa vocation industrielle essentielle.
L’ancrage public de la nouvelle société, tant au niveau des associés qu’à celui de la possibilité de création de filiales aux objectifs à déterminer, représente aussi un des enjeux majeurs. Il en va de même de l’équilibre communautaire et linguistique à respecter dans un contexte bruxellois toujours très sensible à cet égard. Il est aussi certain que la mise à l’agenda des questions environnementales a permis de confirmer l’importance du Port, en termes de mobilité douce.
L’auteure qui est une jeune pensionnée, manifeste un enthousiasme professionnel sans faille pour le Port de Bruxelles auquel elle a consacré une partie non négligeable de son énergie. On devine aussi que cet engagement a dû être total.
Son texte atteste d’un souci méthodique de la précision et du détail significatif pour un lecteur attentif. Au travers de l’histoire administrative du Port, se profilent en effet des luttes et des rapports de force politico-économique typiquement belge que certains ont peut-être pu sous-estimer ou oublier.
La partie II à paraître en septembre 2013, sera logiquement centrée sur le développement du nouvel outil de gestion qu’est le contrat de gestion ainsi qu’à ses avatars. Précisons que chaque partie peut se lire séparément avec bonheur.
L’évaluation des politiques publiques en Wallonie

Une recension de Pierre Moureaux
Avant toutes choses, les auteurs définissent dans une première partie les concepts d’évaluation, de politique publique et d’institutionnalisation. Le flou et l’ambiguïté du premier de ces concepts sont mis en évidence : il est tantôt synonyme de chiffrer ou calculer, tantôt au contraire, utilisé dans le sens de fixer approximativement. Ils relèvent que cette polysémie pourrait constituer une des clés du succès de la démarche. Les auteurs nous proposent d’adopter la définition qu’en donne Steve Jacob et Frédéric Varone dans « L’évaluation des politiques publiques en Belgique » (juin 2001, pp. 7-8, www.uclouvain.be). Celle-ci offre l’avantage d’englober l’ensemble des approches : « L’évaluation d’une politique (publique) consiste en une étude rigoureuse, basée sur des méthodes scientifiques, visant à mesurer les effets de cette politique publique et à porter un jugement de valeur sur ces effets en fonction des différents critères (par exemple, pertinence, efficacité, efficience, économie) ».
F. Fialkowski et D. Aubin précisent ensuite le sens à donner au concept de « politique publique » et nous invitent à adopter la définition souvent citée de Jean-Claude Thoenig : « Une politique publique est un programme d’action propre à une ou plusieurs autorités publiques ou gouvernementales dans un secteur de la société ou dans un espace donné ».
Ainsi, les auteurs relèvent que bien qu’idéalement, une évaluation devrait isoler et mesurer les effets propres, voulus ou non, directs ou indirects, à court ou à plus long terme, d’une politique considérée dans les faits, les rapports d’évaluation se bornent bien souvent à étudier l’effectivité de la mise en œuvre d’une politique, sans se soucier de ses effets. Ils précisent ensuite qu’ils ont incorporé de telles « évaluations » dans le champ de la présente analyse.
Un intéressant distinguo est ensuite effectué entre les activités d’évaluation et le travail de recherche pure. En effet, s’il est patent que les deux activités ont recours aux méthodes et aux techniques des sciences sociales et économiques, l’évaluateur accepte d’être intégré dans une démarche où intervient un commanditaire politique qui joue un rôle dans la définition des questions et des valeurs de références prises en considération. En ce sens, l’évaluation est une activité politique susceptible d’influencer les choix politiques au contraire de l’activité des chercheurs purs, qui revendiquent une pleine autonomie dans leurs pratiques.
Enfin, cette première partie du Courrier s’achève sur les notions d’institution et d’institutionnalisation. La première est définie comme « ... des organisations, des structures, des règles formelles ou informelles qui fournissent aux acteurs des cadres d’action relativement stables et censés assurer une certaine prévisibilité de leur comportement réciproque et, par conséquent, du résultat de l’action collective », la seconde étant vue comme « ... le processus de constitution et de transformation de ces organisations, structures, règles formelles ou informelles ». Ainsi, se situant dans une approche néo-institutionnaliste, les auteurs ne considèrent pas les institutions sous un angle uniquement organique, mais également comme l’existence de règles formelles ou informelles, explicites ou implicites, ce qui implique que le réflexe évaluatif peut être présent en l’absence d’organisme ou de clause formelle dédiés.
Une brève deuxième partie s’intéresse à l’aspect historique de l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques en Wallonie. Les auteurs y décèlent trois phases distinctes. La première, dite « phase réglementaire », résultant essentiellement des prescriptions européennes, se situe au début des années nonante.
La deuxième, dite « phase d’appropriation », se déroule durant la période 1999-2004 : une certaine maturation conduit à trouver dans l’évaluation un outil de gestion, voire un élément susceptible de favoriser le développement régional.
Enfin survient une troisième phase, dite « phase d’institutionnalisation formelle », à partir de 2004, qui correspond à la volonté d’internaliser le processus d’évaluation au sein de l’administration wallonne. Cette volonté se traduit notamment par la création de l’Institut Wallon de l’Évaluation de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) avec un statut de service public, même si cette dernière n’est, selon les auteurs, pas parvenue à s’imposer comme lieu de centralisation de l’ensemble des processus évaluatifs en Wallonie.
Cette deuxième partie se clôt par un stimulant exercice de classement de la Région wallonne sur la scène internationale, en matière d’institutionnalisation de l’évaluation. Pour ce faire, ils ont procédé à un classement suivant deux indices théoriques : l’indice du degré d’institutionnalisation conceptualisé par Steve Jacob et l’indice de maturité proposé par J-E Ferubo. Cet exercice donne à la Région wallonne une position de pointe à l’échelle nationale. Les auteurs relativisent ce résultat en précisant que les indicateurs retenus dans ces classements se concentrent plutôt sur des éléments formels et fort peu sur l’effectivité et la performance des pratiques.
La troisième partie du Courrier, de loin la plus importante, entreprend l’analyse proprement dite de l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques en Wallonie. La volonté des auteurs a été bien sûr d’utiliser les grilles d’analyse conçues pour établir des comparaisons internationales portant sur le degré de maturité et le degré d’institutionnalisation. Cependant, ces dernières ayant l’inconvénient de se situer à un assez grand niveau d’abstraction, ils y ont adjoint des indicateurs plus concrets, en s’intéressant :
![]() à l’ampleur de la pratique évaluative par rapport au nombre d’évaluations menées et à l’étendue des politiques concernées ;
à l’ampleur de la pratique évaluative par rapport au nombre d’évaluations menées et à l’étendue des politiques concernées ;
![]() aux acteurs et structures organisationnelles de l’évaluation, en esquissant les contours d’une cartographie de l’évaluation en Wallonie ;
aux acteurs et structures organisationnelles de l’évaluation, en esquissant les contours d’une cartographie de l’évaluation en Wallonie ;
![]() à la qualité des évaluations en examinant des éléments clés comme les cahiers des charges, les critères d’évaluation, les designs et les méthodes ;
à la qualité des évaluations en examinant des éléments clés comme les cahiers des charges, les critères d’évaluation, les designs et les méthodes ;
![]() à la diffusion et l’utilisation des évaluations.
à la diffusion et l’utilisation des évaluations.
Il ressort globalement de l’analyse que, si beaucoup d’efforts, d’énergie et d’attention ont été consacrés à l’évaluation des politiques publiques en Wallonie, aujourd’hui il n’est même plus imaginable de lancer une grande politique en Wallonie sans prévoir une évaluation et toutes les compétences exercées sont soumises à ces contraintes. Malgré tout, le constat doit être mitigé. En effet, et de façon synthétique, le secteur de l’évaluation souffre de dispersion quant aux pratiques, qui sont trop hétérogènes, cet élément étant à relier avec l’absence d’un acteur référent imposant une cohérence, assurant une coordination des actions et une centralisation des données disponibles ainsi qu’un niveau qualitatif défini. Ensuite, les évaluations menées ne font que très rarement l’objet d’une stratégie de diffusion. Même devant le Parlement Wallon, les médias n’y prêtent qu’une faible attention, sauf en cas d’enjeux polémiques. Enfin, et surtout, quant à leur utilisation, elles ne sont que très rarement envisagées comme instrument de refonte ou de remise en question d’une politique et ne conduisent généralement qu’à de faibles adaptations à la marge.
Construire les futurs
Actes du colloque "Contribution à une prospective au service de la gouvernance". Presses universitaires de Namur.
Pièces jointes
-
Construire les futurs
PDF, 223.7 ko
L’Etat recomposé

L’Etat recomposé - Recension de Florence Daury
Patrick Le Galès et Nadège Vezinat, Paris, PUF, coll. "La vie des idées", 2014, 112 p.
Dans l’ouvrage collectif L’Etat recomposé, coordonné par Patrick Le Galès et Nadège Vezinat, les différentes contributions analysent les dynamiques de recomposition des Etats contemporains, plus particulièrement au travers du cas français. Il s’agit de tenter de répondre à la question très complexe : « L’Etat est-il en retrait ou en développement ? ». Au-delà des éléments purement politiques qui peuvent définir un Etat, l’ouvrage invite à repenser son visage, en prenant en compte les multiples tensions qui s’imposent à lui. Comme l’affirme Patrick Le Galès, « L’Etat n’a plus le monopole de l’action publique ». En effet, le cadre national ne suffit plus à le circonscrire. Les rapports entre les groupes sociaux, les territoires et les entreprises bannissent les frontières et transforment profondément les références institutionnelles classiques. De surcroît, le pouvoir est extrêmement mobile d’un échelon à l’autre, du plus local au plus international, et de la société civile aux institutions publiques. Pour Patrick Le Galès, « l’Etat n’est plus tout à fait l’Etat car les processus d’européanisation, de globalisation et le renforcement du poids de grandes entreprises mondialisées ou de grandes ONG participent de la dénationalisation de l’autorité politique ». De même, partout en Europe, des processus de fédéralisation ont renforcé les niveaux locaux de gouvernement.
Selon le coordinateur de l’ouvrage, un élément central qui permet aujourd’hui de redéfinir l’Etat tient à sa capacité à régler les conflits. L’action publique est évaluée avec ce qui se passe ailleurs par des organisations publiques ou privées, internationales qui produisent des indicateurs ou des classements. Parallèlement, la force régulatrice de l’Europe met en jeu des intérêts mondiaux, produit des normes qui sont parfois contradictoires avec les principes démocratiques. La légitimité politique des instances non élues qui nous gouvernent, l’Europe pour ne citer qu’elle, est souvent critiquée, sans que nos élus semblent pouvoir y faire quelque chose. Vivons-nous dans un monde qui nous dépasse ? Pour le sociologue Wolfang Streeck cité dans l’ouvrage, la crise fiscale (croissance faible et explosion des dépenses publiques) menace les Etats car elle les empêche d’investir pour l’avenir. Les investissements pour les enfants, la recherche et l’enseignement, notamment, pâtissent du mauvais état des finances publiques. La tendance générale est à la réorientation néolibérale, dans la lignée de Margaret Thatcher, et qu’importent les dégâts sociaux que cette pensée peut provoquer. L’Etat gère mais ne gouverne plus. L’Etat doit rendre des comptes et discipliner ses populations, dans l’espoir de sauver ce qu’il reste de la protection sociale dont nous avons joui ces dernières décennies. Les différents contributeurs de L’Etat recomposé ont tous une tonalité plutôt pessimiste, quand à une alternative au capitalisme galopant.
Pour le philosophe Jean-Fabien Spitz, ce néolibéralisme favorable à la concurrence dérégulée remet en cause l’Etat-providence. Il fait cependant la démonstration que ce n’est pas le démantèlement de l’Etat qui va permettre de réduire les coûts et de disposer dans l’avenir de ressources importantes à investir dans la fourniture des biens indispensables ; au contraire, ce démantèlement creuse les inégalités et suscite des besoins artificiels.
L’auteur revient également de façon très intéressante sur le concept de la répartition des richesses. L’idée qu’il existe une répartition des ressources susceptible de récompenser justement chacun est un leurre car la valeur des biens est fonction de facteurs qui n’ont rien à voir avec l’activité des individus, comme la rareté, l’état de la demande, le phénomène de la rente, etc. Il n’y a pas de répartition « naturelle » de la richesse dans une société complexe. Il écrit : « La protection sociale n’est donc pas une concession consentie par les propriétaires naturels des ressources qui accepteraient d’en redistribuer une partie lorsqu’ils le peuvent mais qui seraient contraints de resserrer leur générosité en fonction des circonstances. C’est un choix politique qui s’est imposé entre la fin du 19ème et la fin des années 70 ».
Emilien Ruiz propose la recension de l’ouvrage de Philippe Bezes, Réinventer l’Etat. Les réformes de l’administration française (1962-2008). Le sociologue s’intéresse aux modalités d’un processus de construction sociale qui conduit à ériger l’administration en problème public. A travers toutes les réformes qu’a connues l’administration française, l’objectif principal a été de rendre l’Etat plus efficace. Les conditions d’un tournant néo-managérial sont réunies dans les années 1990, avec les interactions entre les mondes du savoir, de l’administration et du politique. L’Etat s’est donc redéployé via la création d’agences de régulation et les fonctions transversales de pilotage ont été très développées. L’action publique est censée être mieux contrôlée politiquement et financièrement. Mais pour l’auteur, l’introduction de méthodes managériales dans l’administration n’est pas qu’une manifestation d’un tournant néo-libéral. C’est aussi la méthode préconisée par des énarques souvent proches du PS, pour préserver le système existant.
Le texte de Jean-Paul Domin illustre également le paradoxe d’une administration soumise aux outils de gestion du secteur privé, qui reflète en réalité la volonté de l’Etat central de reprendre la main sur l’action publique. La politique hospitalière en France a été marquée ces dernières années par une régionalisation croissante, sous l’influence du modèle britannique. L’objectif est de mettre en concurrence les prestataires de services médicaux par l’entremise du T2A (dispositif de tarification à l’activité, qui permet de comparer des coûts, de faire des classements et de mettre en concurrence les établissements). Les Agences régionales de santé (ARS) créées en 2009 sont dirigées par une personne nommée par le ministère de la Santé. Ce directeur applique les directives décidées à l’échelon national, dont le but se réduit de plus en plus à diminuer les dépenses. Il ne s’agit donc pas d’une territorialisation de la politique mais plutôt d’une mise en cohérence de l’action publique.
Un autre aspect de la recomposition de l’Etat est analysé par le texte d’Emilie Biland, « La fonction publique territoriale (FPT) et la réforme de l’Etat ». Le transfert d’effectifs de l’Etat vers les collectivités (et entre collectivités) ainsi que les nouveaux emplois créés pour faire face aux responsabilités accrues à l’échelon local sont deux évolutions majeures de ces trente dernières années. La fonction publique territoriale est réputée plus politisée et plus ancrée localement que son homologue national. Pour l’auteure, les modalités et l’ampleur du clientélisme local mériteraient d’être mieux examinées.
L’histoire de l’emploi public local est celle d’un enchevêtrement complexe ente encadrement étatique et pouvoirs des élus locaux sur les personnels. La FPT résulte d’un compromis entre deux conceptions opposées de l’emploi public : une coalition favorable à l’autonomie bureaucratique et une coalition favorable au patronage politique. Pour autant, les élus ne font pas « ce qu’ils veulent ». L’Etat, loin d’avoir renoncé à son pouvoir normatif, y est d’autant plus attentif que le développement des collectivités participe de la « cure d’amaigrissement » de ses propres services.
La « territoriale » est présentée comme le fer de lance d’une modernisation rompant avec l’ordre bureaucratique. Pourtant, le mode de gestion des agents publics locaux reste encore dans la lignée du recrutement social. La mobilité géographique concerne essentiellement les cadres. La croissance des effectifs territoriaux se justifie par la politique de réforme territoriale menée par Nicolas Sarkozy et continuée par le Président Hollande.
Comme le relève en postface Nadège Vezinat, les recompositions dont il est question dans ce livre sont multiples. Tant par rapport aux changements d’échelle que dans ses interactions avec la société civile, l’Etat s’appréhende de façon très complexe. Pour l’auteur, « il semble important de ne pas considérer l’Etat comme un ordre social qui va de soi mais plutôt comme un ensemble d’écologies liées ». La société civile se densifie, là où l’Etat se désengage.
La lecture de L’Etat recomposé ne permet pas de répondre à la question de savoir si l’Etat se désengage ou non, de façon univoque. Il apparaît que l’étatisme et le néolibéralisme ne sont pas des concepts opposés. Au XXème siècle, le poids de l’Etat mesuré en termes de rapport entre la dépense publique et le PIB est passé d’un peu plus de 10% à plus de 50 % et 55 % en France. Il serait donc intéressant de voir dans quels secteurs l’Etat investit davantage et dans lesquels elle se désengage, afin de comprendre davantage la recomposition de l’Etat. L’ouvrage pose les bases d’une nouvelle structure institutionnelle et offre un champ d’étude de l’Etat élargi aux mouvements socio-économiques mondiaux qui le traversent, l’influencent, voire réduisent parfois sa souveraineté.
Florence Daury
Vingt ans de politique portuaire à Bruxelles (1993 - 2012) - III. Contrats de gestion 2008-2012 et perspectives

Geneviève Origer, Courrier hebdomadaire du CRISP n°2233-2234, 117 p., 2014
Créé par l’ordonnance du 3 décembre 1992, le Port de Bruxelles fonctionne depuis le 1er juin 1993. Avec la STIB, il est l’un des premiers organismes para-régionaux à avoir conclu un contrat de gestion avec la Région. Aujourd’hui, il gère le second port intérieur belge.
À l’occasion des vingt ans du Port de Bruxelles, le Courrier hebdomadaire étudie les contrats de gestion successifs auxquels a été soumise la société régionale.
L’objectif est d’éclairer les décisions politiques qui ont présidé à l’évolution des installations, du foncier et du fonctionnement du Port, en examinant les positions des différents acteurs régionaux et les arbitrages rendus. Il s’agit également d’analyser la manière dont les contrats de gestion ont été mis en œuvre en fonction des enjeux régionaux, et la mesure dans laquelle ils ont porté le rôle du Port dans l’économie, l’emploi et la mobilité. Cette étude est réalisée par Geneviève Origer, ancienne directrice en charge du développement du Port.
La troisième et dernière partie étudie le contrat de gestion 2008-2012. De multiples aspects de la vie politique bruxelloise sont abordés : PDI, PRDD, PRAS démographique, PPAS Biestebroeck, Plan Canal, Plan Iris 2, Plan de transport de marchandises, etc. Dans une perspective davantage prospective, sont aussi analysés le contenu de l’actuel contrat de gestion (2013-2018), ainsi que le cadre général dans lequel il se déploiera et les grandes décisions et réalisations qui devraient jalonner les années à venir. Par ailleurs, G. Origer livre les résultats des entretiens qu’elle a menés avec les principaux acteurs bruxellois quant à l’avenir du port : mandataires et partis politiques, autorité portuaire, syndicats et organisations patronales, instances d’avis pour les plans d’aménagement et associations d’habitants et environnementales.
L’institution psychiatrique au prisme du droit. La folie entre administration et justice

Sous la direction de Geneviève Koubi, Patricia Hennon-Jacquet et Vida Azimi, Editions Panthéon Assas, 2015.
Compte rendu par Alexandre Piraux (CERAP-ULB)
Cet ouvrage collectif consacré à la gestion des fous par le droit et l’institution psychiatrique sous toutes ses formes est nourri de contributions très riches. Nous ne pourrons malheureusement pas toutes les passer en revue pour des raisons de limite matérielle. Nous avons donc choisi au moins un des textes dans chacune des trois parties de l’ouvrage et aussi parmi les contributions qui sont apparues les plus signifiantes ou caractéristiques de la problématique, ce qui ne préjuge nullement de la pertinence des autres.
L’objet de cet ouvrage collectif est de décrire et d’analyser les liens croisés, les entrelacements entre les règles de droit et l’institution psychiatrique, à travers le temps. Ces interactions historiques entre la psychiatrie et le droit ont fait l’objet du colloque des 16 et 17 octobre 2014 organisé par l’Université Panthéon-Assas (Paris II) sous l’égide du Centre d’études et de recherches de science administrative et politique (CERSA-CNRS). La pluridisciplinarité des regards portés sur la place et le traitement de la folie dans la société enrichit l’ouvrage.
Dès l’introduction, les trois coordinatrices de l’ouvrage font observer qu’à l’aube du XXIe siècle, un rapport d’une Commission d’enquête sur la situation dans les prisons françaises constatait que « la prison est finalement souvent le seul lieu d’accueil des personnes souffrant de troubles psychiatriques graves ». Ce qui pose aussi implicitement la question du traitement des personnes dont on n’espère plus la guérison.
Pour planter le décor, elles relèvent aussi que dès le VIIe siècle, les Bîmâristân (hôpital en persan) du monde arabo-musulman ont précédé et inspiré les modèles occidentaux bien au-delà le Moyen Age.
Les malades de l’esprit y étaient traités comme des êtres humains et soignés avec l’objectif de leur réintégration sociale.
La contribution de Vida Azimi, « Le Fou dans l’administration », est particulièrement originale tant dans son sujet que dans son contenu. Elle pose en fin de compte la question iconoclaste de savoir s’il existe une psychopathologie spécifique au monde administratif. Introduire la question revient sans doute à y répondre.
L’auteure mentionne d’abord la quasi inexistence de sources et la pauvreté des éléments dans ce domaine alors que les services sont d’habitude si diserts dans leurs rapports. [1] Parmi les explications, la crainte du scandale, la protection de la dignité et la « sacralisation des fonctions » sont avancées comme éléments de réponse. Un seul ouvrage, celui du docteur Réveillé-Parise, fait état de la pathologie du fonctionnaire au sens strict. Il date de … 1839. Il ressort de ce genre d’ouvrage que l’administration en soi crée un climat anxiogène et que les services sont pour ainsi dire « des hôpitaux par anticipation » et cela ne concerne pas que les agents surnuméraires mais également le secrétaire général et même le ministre.
Vida Azimi a recours à une galerie de portraits littéraires pour éclairer son sujet, ce qui va de Messieurs les ronds-de-cuir de Georges Courteline qui est un vaudeville noir puisque les délires d’un commis Monsieur Letondu finissent par tuer son infortuné chef de service, à la nouvelle de Gogol, Journal d’un fou, ce dernier étant lui-même fonctionnaire et neurasthénique. Il semble bien à cet égard que la littérature russe regorge de fonctionnaires déments ou déséquilibrés. Cela s’expliquerait par l’écart démesuré des situations professionnelles et par le fait que les agents subalternes sont considérés comme des « hommes de petite envergure » dans le système russe de la Table des rangs (le tchin) instituée par Pierre le Grand comme une « noblesse du service » concurrençant la noblesse de sang. La contributrice retrace également trois parcours emblématiques de personnages ayant exercé des fonctions publiques soit comme haut magistrat, ou comme célèbre professeur et philosophe auprès de l’Ecole Normale Supérieure ou en qualité de simple militaire. Ces personnages ont comme point commun d’avoir à un moment donné basculé dans la folie. Ce récit de cas extrêmes ne peut qu’émouvoir, tant la dimension de la fragilité humaine de personnalités parfois très éminentes dans leur discipline, nous concerne tous potentiellement. Le rapport des trois personnages à la figure du père incarné symboliquement dans leur cocon administratif ou dans le giron de l’Etat relie les récits. L’administration est comparable à un milieu familial protecteur et en même temps dangereux.
En Europe, comme le rappelle le Professeur Jacques Chevallier dans « Heurs et malheurs de l’institution psychiatrique », l’institution psychiatrique a été édifiée à partir d’un principe d’enfermement. Ce « grand renfermement » s’est produit au milieu du XVIIe siècle. A cette époque, on interne aussi bien les insensés que les errants, les mendiants, ou les « correctionnaires » dans des « hôpitaux généraux » (le premier est fondé en 1656 à Paris) chargés d’accueillir les diverses catégories de marginaux. Il s’agit de protéger la société contre les menaces de désordre via notamment ces mesures de « police ».
Ce sont des raisons surtout économiques qui vont mettre fin au « grand renfermement » et ce dès avant la Révolution française. L’enjeu est en effet de mettre ou remettre au travail les indigents valides dans un monde qui va commencer à s’industrialiser.
Ensuite la médicalisation de la folie préconisée par les travaux des Pinel et Esquirol va confirmer en la justifiant la logique d’enfermement mais pour d’autres raisons à savoir une finalité thérapeutique. L’asile constitue une microsociété coupée de son environnement. L’existence se déroule dans le même espace-temps. La logique disciplinaire conduit à une « codification intégrale des conduites » et les règlements intérieurs tatillons produisent des comportements conformes. On se trouve donc dans un modèle d’institution totale qui sera parachevé en France par la loi de 1838.
La contribution de Jacques Chevallier montre aussi qu’en ce qui concerne l’enfermement puis l’internement, on est passé d’un contrôle quasi unique du médecin dans le sens où il y avait fusion du pouvoir médical et administratif, à un contrôle dual médecin et préfet, et enfin à un contrôle trinitaire où la figure du juge s’affiche davantage.
Le texte de Patricia Hennion-Jacquet, « La psychiatrisation du droit pénal. Entre fusion et confusion », est particulièrement engagé. Dans une époque caractérisée de façon générale par la confusion et par la fusion due à un refus ou à un déni des différences, certains seront sans doute peu surpris de découvrir que selon l’auteure, la fusion entre la psychiatrie et le droit pénal va engendrer une série de confusions. Selon Patricia Hennion-Jacquet, le durcissement de la politique criminelle contribue à l’assimilation du malade mental à un délinquant : « … poussé par le populisme pénal et le mouvement victimologiste, le législateur a orienté la politique criminelle vers une logique de l’emprisonnement ». Le juge pénal pose également de nouvelles questions sur la dangerosité et la faculté de l’accusé à recevoir des soins et à se réinsérer socialement. Or l’évaluation de la dangerosité de l’auteur d’une infraction conduit à une confusion entre folie et délinquance. L’individu est de plus en plus souvent jugé pour ce qu’il est supposé faire dans l’avenir, et non pour ce qu’il a fait.
La contribution de Geneviève Koubi, « Courts circuits circulaires du service public en santé mentale », nous apprend que « les circulaires détiennent parfois une qualité spécifique qui peut faire apparaître comme anticipatrices des réformes, préfiguratives des lois et des règlements, annonciatrices de bifurcations organisationnelles… ». L’auteure se réfère ici à deux circulaires de 1960 et 1990.
Celle du 15 mars 1960, préparée par des administrateurs convaincus par les propositions avant-gardistes de psychiatres, forme un exemple très emblématique. Elle constitue pour ainsi dire la fin des asiles et annonce une restructuration des hôpitaux psychiatriques. L’hospitalisation du malade ne constitue qu’une étape de son traitement. Cette circulaire amorce « la mutation de la psychiatrie publique ».
Une circulaire de 1990 achève cette mutation et annonce la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.
La contributrice considère que depuis la loi de 2011, un retour à la contrainte s’effectue et « destitue la notion de liberté » recouverte par une notion de protection. Ce « schéma de protection », de la société de la famille, de l’entourage, « trace une ligne de convergence entre les discours juridiques et administratifs sur la psychiatrie publique ». En tous les cas, l’évolution récente révèle une multiplication des tensions entre des droits relevant de la sphère privée (la santé mentale, la libre circulation des malades et leur réintégration sociale) et des droits appartenant à la sphère publique (la protection de la société).
Le texte de Katia Lucas, « Les transformations de la doctrine de l’administration en matière de santé mentale », est axé sur la prise en compte mondiale et européenne de la santé mentale, essentiellement dans la dimension de coût économique et social de ces pathologies. L’auteure part d’emblée du Pacte européen pour la santé mentale et le bien-être de 2008. La santé mentale est qualifiée de droit de l’homme par ce Pacte européen. Dans ce domaine, observe Katia Lucas, on constate (en France) une accélération du temps juridique et un activisme du législateur depuis 2011. La contribution décrit la récente prise en compte accrue de la vulnérabilité juridique et sociale des individus en souffrance psychique. La protection des individus est renforcée face aux mesures d’internement abusives ainsi qu’aux modalités de sa prise en charge hospitalière. Il s’agit pour les thérapeutes de travailler sur la capacité des personnes en vue de leur faire consentir aux soins, dans le cadre d’une alliance thérapeutique mais sans pour autant en faire une obligation juridique positive.
Le fil rouge des dernières lois est celui d’une logique inclusive visant à maintenir le lien social et celui d’une diversification des prises en charge médicale alternatives à l’hospitalisation. Il y a donc une gradation dans l’approche clinique des pathologies mentales et un pluralisme des modes d’intervention : soins ambulatoires, soins à domicile dispensés par un établissement accrédité, hospitalisation à domicile, séjours à temps partiel ou de courte durée à temps complet dans un établissement équivalent, etc …
Ces évolutions sont dues à différents facteurs tels qu’un changement des mentalités et des représentations sociales de la maladie mentale, les recommandations du Conseil de l’Europe et surtout, selon nous, la prise de conscience accrue des coûts de l’hospitalisation. Un rapport de la Cour des comptes de 2011 en témoigne.
Une contribution du Collectif Contrast, « La régulation des pratiques contraignantes de soin en santé mentale : perspectives pour une approche interdisciplinaire », clôt cet ouvrage. Il s’agit d’un Collectif interdisciplinaire [2] qui rassemble des chercheurs de différentes disciplines (sociologie, droit, philosophie) dans le but d’étudier les recompositions des régulations des pratiques contraignantes dans le soin, tout particulièrement dans le domaine de la santé mentale.
Ce texte relève qu’on est parti d’une forme pyramidale d’encadrement des pratiques de soin en santé mentale pour en arriver à un encadrement régulatoire faisant appel au droit souple.
En France, la loi de 1838 consacrait l’aliénisme. Celle loi donnait un mandat général aux psychiatres, portant non seulement sur des actes médicaux mais aussi sur le travail, les sources de revenus ou la gestion des biens des malades.
Ce n’est que dans les années 1960-1970 que les règles juridiques vont se diversifier et que les pratiques professionnelles se fragmenter par disciplines (mandataires judiciaires, assistants sociaux, …).
C’est aussi à la même époque que de nouvelles instances administratives plus autonomes vont être créées avec pour vocation de garantir les droits fondamentaux et d’influencer la production de normes juridiques de protection des droits. Ces nouvelles autorités administratives indépendantes, dotées d’une compétence d’expertise, contrôlent et évaluent les pratiques en santé mentale.
Le Collectif observe aussi qu’il existe de plus en plus de règles juridiques formalisant les comportements ou les relations sociales (ce qu’on appelle la juridicisation) mais que ces règles juridiques relèvent du « droit souple » et sont donc caractérisées par leur faible degré de contrainte (pas de sanction, il s’agit de susciter l’adhésion des destinataires). On assiste ainsi à une multiplication de chartes, de recommandations, de circulaires, de directives, etc ... à la valeur juridique plus ou moins floue. Si certaines pratiques liées aux actes d’aller et venir des malades sont très régulées, d’autres pratiques comme l’écoute ou l’alimentation le sont beaucoup moins.
Et la situation en Belgique ?
En Belgique, les compétences en santé mentale sont passées du ministère de la Justice à celui de la Santé publique à la fin des années 1940, confirmant par-là , de façon institutionnelle, le passage d’un régime sécuritaire visant le contrôle social à une médicalisation de la maladie mentale, dans le cadre de l’Etat-providence conférant aux individus des droits-créances, par exemple le droit aux soins psychiatriques [3].
La forme de l’Etat-réseaux, qui a succédé à la forme de l’Etat-Providence, accorde par contre beaucoup d’importance à la notion de droits-participations notamment des associations représentatives, des plates-formes de concertation en santé mentale concrétisant les droits-participations des usagers, dans notre cas les personnes malades et leur entourage. Dans ce contexte, le patient se retrouve dans un circuit de soins au sein d’un réseau de soignants [4] qui met en exergue le rôle accru du généraliste dans le dispositif de soins. Malgré tout, l’imaginaire hospitalier domine toujours les représentations sociales et le champ thérapeutique.
A ce jour, le ministre de la justice peut décider qu’après l’exécution de la peine, la personne est mise à la disposition du gouvernement s’il estime que cette personne constitue un danger pour la société ou que la réinsertion sociale n’est pas possible. Il s’agit d’une peine supplémentaire pour une période de minimum 5 ans à maximum 20 ans.
Dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat (2011-2014), les compétences en matière de santé mentale (dont la loi de Défense sociale de 1964 organisant l’internement et la psychiatrie légale) ont été transférées de l’Etat central aux entités fédérées.
La réglementation existante reste d’application jusqu’à ce qu’une Communauté ou une Région décide de modifications ou de nouvelles règles. On peut donc augurer qu’une politique publique différente sera initiée par chaque entité fédérée du nord et du sud du pays avec des moyens financiers indexés sur la richesse de la région concernée.
On constate aussi la difficulté pour les services médico-psychosociaux d’assumer la double tâche d’expertiser et donc d’évaluer la personne et de mener avec elle un travail thérapeutique, ces deux fonctions étant absolument contradictoires.
Cette remarque renvoie à la question de l’expertise judiciaire. Comment les experts sont-ils choisis et accrédités ? Il n’y a en effet pas d’appel à candidatures ni de procédure pour objectiver et légitimer la qualité d’expert devant les Cours et tribunaux alors que les experts, selon le Docteur Michel Bataille, coordinateur à l’Etablissement de Défense sociale de Paifve (Belgique), disposent d’un pouvoir exorbitant. De surcroît, la procédure d’expertise n’est pas contradictoire.
Pour en revenir à l’ouvrage collectif, l’une de ces grandes qualités, outre la diversité et parfois l’engagement courageux des intervenants, est de nous rappeler que l’évolution des politiques en matière de santé et les formes de prise en charge de la santé mentale (asile, hôpital, habitation protégée) sont en lien direct avec la transformation des rôles de l’Etat. On retrouve aussi comme invariable le rapport entre deux logiques, celle de l’Etat et celle du savoir thérapeutique.
Cet ouvrage mérite d’être lu de manière anthropologique, c’est-à -dire comme source de réflexion pour le « parfait honnête homme » soucieux des libertés publiques mais aussi de manière plus technique par les spécialistes médicaux ou juridiques.
Selon Dostoiëvski, « Nous ne pouvons juger du degré de civilisation d’une nation qu’en visitant ses prisons ». Nous pouvons transposer cet adage et affirmer que nous pouvons juger du degré de notre civilisation en examinant le sort que nous réservons aux « fous ».
La place que nous donnons à la différence révèle notre degré de civilisation et d’humanité.
Pièces jointes
-
Folie - argumentaire
PDF, 283.6 ko
La Gouvernance par les Nombres

Alain Supiot, La Gouvernance par les Nombres, cours au Collègue de France (2012-2014), Fayard, poids et mesures du monde, 2015.
Compte rendu par Alexandre Piraux
Cet ouvrage est la publication des cours donnés par Alain Supiot au Collège de France de 2012 à 2014. Il traite de gouvernance et de démocratie.
Mais ce livre analyse aussi surtout les rapports entre le droit et le management. [1]
On se souviendra à ce sujet que le ministre de la Fonction publique Luc Van den Bossche avait déclaré en 2001 que « Le management prime le droit ». A l’époque une telle proclamation avait été prise pour une pure provocation gratuite, sans lendemain.
Il semble bien que cette boutade soit devenue en grande partie réalité, du moins si l’on en croit la thèse du Professeur de droit à l’université de Paris Panthéon-Assas, Alain Supiot : « … la loi ne gouverne plus car elle est à son tour asservie au fonctionnement d’une machine à calculer ». La loi devient elle-même un produit législatif assujetti au calcul d’utilité, et qui est mis en concurrence sur le marché mondial des normes.
L’ouvrage révèle de surprenants rapprochements entre le communisme réel et l’ultralibéralisme à savoir :
- - la volonté d’asseoir l’ordre économique de la société sur des bases scientifiques et non plus sur des liens politiques ;
- - le droit ne serait qu’un simple instrument de mise en œuvre d’objectifs, en tant qu’ustensile, il est jugé à son efficacité ;
- - la croyance que la structure étatique est appelée à disparaître à terme.
Pour l’essayiste, la représentation statistique de la société issue de la gouvernance par les nombres « congédie le réel au profit de sa représentation mathématique ». C’est là un élément nodal de la démonstration à savoir que la représentation chiffrée du monde est déconnectée de l’expérience et donc du réel et que, dans ces conditions, on prend la carte pour le territoire.
Alain Supiot insiste beaucoup sur le fonctionnement de la gouvernance selon un modèle de rétroaction en temps réel aux signaux reçus. Dans ce modèle, il n’est plus question pour l’administration de conseiller l’action publique du prince et d’anticiper mais de devoir réagir, sur instructions ministérielles, aux sondages, catastrophes, grèves, et autres évènements médiatiques.
Par ailleurs, la tenure-service redevient la forme normale d’exercice des Services économiques d’intérêt général. Alain Supiot ne prétend nullement que nous retournions au Moyen Âge mais affirme que les concepts juridiques de la féodalité procurent des grilles de lecture des bouleversements institutionnels dans le secteur public mais aussi dans le secteur privé.
En effet, l’auteur décèle dans le droit contemporain « de nouvelles techniques d’inféodation des personnes et de concession des choses ». Ces techniques apparaissent aujourd’hui sous la forme des réseaux. Cette approche est redevable à la cybernétique qui permet un fonctionnement du monde comme « un réseau de particules communicantes ». Or le réseau est la forme typique du monde féodal. Et dans ce cadre, la loi fait place au lien et donc au contrat.
Mais ces « contrats » sont très encadrés et ne sont pas de vrais contrats fondés sur l’autonomie de la volonté des parties mais plutôt des actes d’allégeance qui obligent l’un à se conformer aux attentes de l’autre. Ainsi l’Etat confie le soin aux personnes privées ou publiques de définir elles-mêmes les modalités de réalisation des objectifs qu’il leur fixe tout en se réservant la possibilité de rétroagir aux manquements constatés grâce au monitoring électronique évaluant quantitativement la performance.
Divers facteurs explicatifs à l’essor des privatisations sont abordés et il est intéressant d’en relever certains qui sont souvent peu mentionnés.
Ainsi, un service public qui est privatisé se métamorphose et d’une charge publique devient, comme par enchantement, un facteur économique de croissance dans les comptes de la nation (p. 377), du fait que le prix du service devenu commercial est augmenté.
Pour tendre vers l’ « indicateur objectif » des 3% du déficit accepté du PIB, les Etats transfèrent au secteur privé les déficits des services antérieurement prestés par le secteur public. Ainsi en va-t-il de la baisse régulière de la prise en charge du « petit risque » par l’assurance maladie qui a pour effet d’augmenter le marché des assurances privées (p. 251). Dès lors, la couverture santé assurée ne couvre pas ceux qui sont trop pauvres pour la financer. L’avantage est que les comptes publics sont améliorés tout comme les indicateurs mais au détriment de la protection sanitaire de la population.
Dans la seconde partie dédiée à l’évolution des régimes de travail, l’auteur constate aussi l’imprégnation du scientisme qui a introduit le taylorisme en tant qu’organisation scientifique du travail louée aussi bien par le patronat que par Lénine qui y voyait « un immense progrès de la science ».
Il prend acte comme beaucoup avant lui, de la fin du compromis fordiste issu de la Première Guerre mondiale. Ce compromis du nom d’Henri Ford, octroyait aux ouvriers une part de la productivité obtenue grâce à l’organisation taylorienne du travail. Ce welfare capitalism qui élargissait le champ de la justice sociale, a mis de côté la question de l’organisation du travail en considérant qu’elle relevait de la technique et de l’efficacité et non de la justice.
La révolution numérique a conduit à penser le travail non plus sur le modèle mécanique mais sur celui de l’ordinateur. Cette mutation du régime de travail signifie la capacité de réagir en temps réel aux signaux (feedback) afin de performer les objectifs fixés par le programme. Autrement dit, leur disponibilité et réactivité rend totalement mobilisables les travailleurs. Cette mobilisation entraîne une certaine autonomie dans la manière de procéder, mais « … cette autonomie est une autonomie dans la subordination, ce qui implique moins de sécurité contractuelle et davantage de responsabilités » (p. 370).
Pour affronter ces nouveaux risques, et en guise de compensation, les droits du travailleur sont personnalisés, dans le sens où ils ne plus justifiés par l’appartenance à une profession ou à une entreprise mais sont opposables à tout employeur. Ce sont en quelque sorte des droits de tirage sociaux. Par exemple, le droit d’être soutenu dans son aptitude professionnelle, de recevoir une qualification mise à jour régulièrement, de bénéficier d’un encadrement psychologique au sein de l’entreprise.
« Comment en sortir ? »
Tel est le titre du dernier chapitre du livre.
Le statu quo parfois adopté par certains n’est pas une solution dans un environnement changeant à une vitesse exponentielle pas plus qu’une gouvernance illimitée par les nombres.
De plus, on assiste à un processus d’inversion des normes, les accords particuliers primant sur la loi générale. Les intérêts privés surplombent les intérêts publics, au prétexte que l’ensemble des vices privés engendrerait des bénéfices publics, selon la doctrine utilitariste notamment celle de Bernard Mandeville au XVIIIème siècle.
De fait le règne de la loi est renversé. Cette dernière est asservie à des calculs d’utilité individuelle. Dans cette conception, le droit est un pur produit relevant d’un savoir technique et soumis à une concurrence mondiale sur le marché des normes. Dès lors la privatisation des services publics et la déréglementation du marché du travail ne sont plus des programmes politiques mais des mesures techniques (p. 172).
La façon de penser le droit en branches établie par les juristes de la Renaissance est, selon Alain Supiot, en train de se clore et comme on l’a vu plus haut, certains indices établissent un retour des façons de faire des juristes médiévaux qui puisaient dans des principes généraux ou des règles prises de matières différentes.
Dans un autre registre, l’auteur note que « le principe de solidarité est aujourd’hui le principal obstacle auquel se heurte le Marché pour s’imposer totalement face à l’ordre juridique » (p. 414).
L’Etat a perdu « le monopole de l’organisation des solidarités » et les formes de solidarité qu’il a mises en place sont déstabilisées. Mais l’Etat « doit devenir le garant de l’articulation de la solidarité nationale avec les solidarités civiles et les solidarités internationales » (p. 416).
Pour ce faire, une première avancée serait la restauration du principe de démocratie, non seulement dans la sphère politique mise à mal par l’Union européenne mais également dans la sphère économique pour rendre à chaque travailleur « une prise sur l’objet et le sens de leur travail » (p. 416).
L’auteur pense aussi qu’un bon usage de la quantification implique un sens de la mesure que le droit, du fait qu’il est autonome dans sa sphère, peut apporter, en imposant le respect du contradictoire. On pourrait aussi ajouter selon nous, et du principe de proportionnalité et du raisonnable pour retrouver le sens des limites.
Mais comme le reprend l’auteur citant Roland Barthes « l’histoire n’assure jamais le triomphe pur et simple d’un contraire sur son contraire : elle dévoile, en se faisant des issues inimaginables, des synthèses imprévisibles ».
Nous ne saurions que recommander la lecture de cet ouvrage stimulant qui donne à réfléchir sur la mondialisation qui n’implique pas « l’uniformisation du monde sur le modèle occidental », sur les usages du droit, et bien sûr sur une gouvernance obsédée par les nombres et la quantification de l’existant, ce qui a pour effet de chosifier les humains.
Chaque chapitre contient des perles d’érudition pertinente (le nomos grec, la lex romaine, la révolution grégorienne qui sépare les pouvoirs temporels et spirituels, l’ordre rituel, l’Ecole des lois en Chine, etc …) et met en perspective les diverses thématiques. Un lecteur pressé peut à la limite ne lire que la partie l’intéressant plus particulièrement de façon séparée, mais il risque de perdre une partie de la cohérence du tout.
La Région de Bruxelles-Capitale et la sécurité après la sixième réforme de l’Etat

Un article de Jean-Paul Nassaux
"La sécurité en région bruxelloise est un sujet politiquement très sensible. Voici près de dix ans, une étude publiée par la revue en ligne Brussels Studies constatait la situation singulière de Bruxelles sur ce plan. Elle relevait qu’il y existe d’importants problèmes de sécurité liés à la mobilité des travailleurs (navetteurs, sécurité routière...), aux mouvements de population (immigration, délinquance internationale...), aux activités économiques (délinquance financière, fiscale et environnementale) ou au maintien de l’ordre lié à la présence sur le sol régional d’institutions internationales et nationales ainsi qu’au déroulement des sommets européens dans la capitale. Par ailleurs, hormis la menace terroriste qui s’est développée au cours des dernières années, certains faits divers sont de nature à alimenter l’idée que Bruxelles est une ville dangereuse et peuvent donner une acuité particulière au débat sécuritaire, duquel n’est pas absente une dimension communautaire. Enfin, la répartition des compétences relevant de la sécurité entre les différents niveaux de pouvoir opérant en région bruxelloise fait elle-même débat, dans le cadre plus large des évolutions institutionnelles que le pays a connues depuis une décennie.
Ces différents éléments ont conduit à une évolution significative du rôle de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de sécurité, en particulier à l’occasion de la sixième réforme institutionnelle décidée par l’accord du 11 octobre 2011. Ces changements n’ont toutefois
pas clos le débat".
Travailler chez bpost. De l’esclavagisme moderne ?

Texte faisant suite à la lecture du Courrier hebdomadaire du CRISP n°2326-2327, " De La Poste à bpost : histoire d’une mutation (1991-2015)", Jean Vandewattyne, John Cultiaux, Rebecca Deruyver, 2017.
En savoir plus sur le Courrier du CRISP
"Chacun devrait avoir conscience que c’est une chance qu’un facteur passe chez toi, tous les matins. Sans quoi, c’est le bordel. Les gens ne font que gueuler. Les anciens sont accablés de voir ce que la Poste est devenue. Ils assistent à la démolition méthodique de tout ce qui fonctionnait, et en plus il leur faut écouter les bouffonneries des tarés sortis d’écoles de commerce qui leur expliquent comment devrait marcher la distribution du courrier alors qu’ils n’ont jamais vu un casier de tri de toutes leurs chères études". (V. Despentes, Subutex)
Dans un Courrier hebdomadaire, le CRISP nous livre le récit : « De La Poste à bpost : histoire d’une mutation (1991 – 2015) ». Le quart de siècle retracé par les auteurs est effectivement décisif pour l’avenir des services postaux belges mais il a aussi ceci d’universel qu’il est à l’image de notre société hyperconcurrentielle, capitaliste et parfois, déshumanisée. Découvrir l’histoire de La Poste à bpost, c’est un peu comme revoir l’évolution des temps depuis le Moyen-Âge à nos jours et se sentir impressionné par les changements accomplis tout en se demandant, nostalgique, si quelque chose d’essentiel n’a pas été perdu en chemin.
Venons-en aux faits. Au début de la décennie 1990, dans un monde largement dominé par les visions néolibérales, La Poste est un paquebot comptant 46285 travailleurs, la plupart à la culture syndicale fortement ancrée. Le panorama postal européen (en particulier allemand et néerlandais) est plutôt visionnaire, les opportunités technologiques d’informatisation et d’automatisation deviennent incontournables, tout comme la nécessité de moderniser l’entreprise pour faire face à la libéralisation des marchés et la fin des monopoles publics. Entre 1996 et 1999, après trois années déficitaires, l’administrateur délégué de La Poste, André Bastien (ancien chef de cabinet de Guy Coëme, par ailleurs poursuivi dans l’affaire Agusta-Dassault où il sera condamné en 1998 à six mois de prison avec sursis et 6000 francs belges d’amende) annonce sa volonté de couper dans les coûts du personnel, qui représentent 80,6 % des dépenses totales, en réduisant les effectifs et demande à l’Etat une aide financière de 334 millions d’euros. Elio Di Rupo, Ministre en charge à l’époque, conditionne ce plan à un accord avec les syndicats qui restent arcboutés sur leurs droits. C’est l’impasse.
Le retour au pouvoir des libéraux en 1999 va changer la donne. Le nouveau Ministre des Télécommunications et des Entreprises Publiques, Rik Daems (VLD) place à la tête de La Poste Frans Rombouts. C’est un top manager issu du privé dont l’ambition est de « transformer La Poste en une entreprise moderne et performante ». Il forme un tandem avec Pierre Klees, nouveau Président du Conseil d’administration, surnommé Octopus pour sa faculté à être partout en même temps. Dans le plan stratégique de Frans Rombouts, la diversification des activités occupe une place essentielle. La Poste se transforme en holding, Belgian Post Group (BPG) chapeautant une dizaine de filiales dans lesquelles le courrier privé ne représente plus qu’une petite partie. Les tensions sociales restent vives et dans une interview, le patron de La Poste parle de l’état désastreux des infrastructures qui ralentissent le rythme des changements. Concernant les conditions de travail, il parle d’esclavagisme moderne, avec des postiers « assis sur des caisses » et travaillant au milieu d’une poussière qui provoque « des pannes du matériel informatique complètement vétuste ». Au sujet de son prédécesseur, il parle d’un administrateur délégué seul face à 40000 travailleurs, ce qui aurait permis aux syndicats mieux organisés de gérer l’entreprise. En novembre 2001, interrogé par la presse qui lui demande si La Poste subira le même sort que la Sabena, Frans Rombouts répond qu’il est néfaste que le pouvoir politique dicte « sa loi », ce qui a évidemment pour effet de crisper les relations avec une partie du gouvernement. A ce climat de tensions s’ajoute l’annonce de la fermeture de 400 nouveaux bureaux de poste jugés non rentables et la relocalisation des centres de tri, réduits à trois au lieu des cinq évoqués dans le passé. En décembre 2001, invoquant des problèmes de communication et des retards pris dans la modernisation de l’entreprise, le gouvernement décide de limoger Frans Rombouts et de le remplacer par Johnny Thijs.
A son arrivée, le nouveau boss, également issu du privé mais déjà au conseil d’administration de La Poste depuis 2000, relève que sa priorité sera de « rétablir un climat de sérénité avec les partenaires tant internes qu’externes de La Poste ». Reprenant le dossier des centres de tri en main, Johnny Thijs revient au plan stratégique initial prévoyant la construction de cinq nouveaux centres de tri, avec pour objectif un niveau d’automatisation de plus de 90% au lieu des 50% en cours jusqu’alors. En échange, les syndicats concèdent des sacrifices, notamment le gel des salaires et le report de la réduction du temps de travail de 38 à 36 heures au 01 janvier 2005. Les syndicats sont tétanisés par le sort qu’a connu Sabena et se laissent plus facilement gagner par les impératifs de rentabilité dont l’entreprise a besoin.
Johnny Thijs met également fin à la politique de diversification de Frans Rombouts pour se recentrer sur les activités Mail et Retail. Au vu des changements à opérer, la mutation est fastidieuse et les comptes sont dans le rouge. Le Président Pierre Klees compare La Poste à Jurassic Park : « il y a cinquante ans que du retard a été pris ! On prend du retard dans la récupération du retard du passé ». Johan Vande Lanotte (SP.A) en poste depuis juillet 2003 déclare souhaiter voir La Poste revenir à l’équilibre budgétaire en 2004. Ce à quoi répond Johnny Thijs : « ne plus faire de perte c’est facile, il suffit de stopper tous les investissements. Mais alors, il n’y aura plus de poste belge en 2010 ». En 2004, les coûts sont finalement maîtrisés suite notamment à une réduction drastique des effectifs, la fermeture de bureaux de poste, l’ouverture de Points Poste et le développement d’une gamme de produits commerciaux. L’année 2005 apparaît encourageante et les deux dernières années du premier mandat de Johnny Thijs, en 2006 et 2007, se clôturent sur des résultats financiers très positifs. En 2006, le chiffre d’affaires a augmenté de 6% par rapport à 2005 et en 2007, il atteint 2,276 milliards d’euros, soit une hausse de 2% par rapport à 2006. Notons qu’en 2006, l’ouverture du capital au consortium formé par la poste danoise et le fonds d’investissement CVC Capital Partners aura permis à La Poste de bénéficier de capitaux frais pour poursuivre sa mutation et s’affranchir partiellement de l’Etat actionnaire. En 2009, la poste danoise se retire de l’actionnariat, réalisant une plus-value de 138 % en 36 mois. L’entrée en bourse en 2013 rapporte à CVC 812 millions et dans un second temps, 580 millions supplémentaires. La politique de dividendes de l’entreprise rapporte à l’Etat 834 millions d’euros entre 2008 et 2014.
Si bpost connait une santé florissante, elle le doit en partie au tribut que le personnel aura dû payer et paye toujours actuellement. Les licenciements secs ont été évités grâce à une pyramide des âges atrophiée parmi les travailleurs mais les conditions de travail durant un quart de siècle se sont détériorées, devenant parfois chaotiques au rythme incessant de restructurations et d’« améliorations organisationnelles », comme les multiples tentatives de déploiement du logiciel Georoute, stoppées à maintes reprises par les syndicats. Ce logiciel canadien est conçu pour calculer l’itinéraire idéal de distribution du courrier, en tenant compte de critères comme le relief du paysage, la charge de courrier, les temps alloués pour le travail et les temps de repos. Les relations avec les syndicats tournent au pugilat, en particulier avec la CSC Transcom qui par la voix de son patron André Blaise, considéré comme l’empêcheur syndical de tourner en rond, déclare qu’un « agent de 25 ans à la Côte n’effectue pas sa tournée au même pas qu’un facteur de 60 ans dans les Ardennes ». La bataille autour de la question de Georoute s’étendra de juin 2002 à décembre 2003. Mais ce qui fut plus grave, avant que le phénomène d’ubérisation arrive à nous aujourd’hui, a été l’apparition en 2010 des facteurs de quartier. Rebaptisés les facteurs low-cost, les syndicats signeront néanmoins un accord pour valider leur recrutement. Sauf la CSC Transcom qui juge inacceptable qu’un nouvel agent soit payé 20% de moins qu’un agent statutaire. Et le truculent patron syndical André Blaise de déclarer à la presse : « Même dans le privé, de tels salaires (10,57 € bruts de l’heure), ça ne se fait pas. Et c’est l’Etat qui octroie ces salaires de misère ! ». Les conditions offertes sont si peu reluisantes que bpost avoue elle-même avoir du mal à recruter. Dans certains services, le taux de turnover s’élève à 100 %.
Désirant changer son image, La Poste devient bpost le 17 janvier 2011 et se présente comme une entreprise « jeune et dynamique ». Une publicité fait les pleines pages des journaux et est distribuée à près de 4,5 millions de ménages. On y voit des facteurs qui, tels des coureurs d’un 110 mètres haies, courent et enjambent avec « ambition » et « énergie » le nouveau logo de l’entreprise. Dans la réalité, le travail du facteur, graduellement modifié suite à l’automatisation croissante du tri, se concentre alors sur la distribution du courrier, soit une moyenne de 7h et 36 minutes de travail dehors. Suite aux plaintes du personnel et des syndicats, bpost commande – dans le cadre d’une série d’initiatives destinées à améliorer le bien-être du personnel et nommée de manière follement originale bpeople… – une étude de faisabilité physique des 7h36 à l’extérieur au BLITS, un laboratoire de la VUB. Selon le professeur Bas de Geus, les conditions de travail sont faisables mais il faut « une alimentation saine, ne plus fumer et faire du sport ». Les facteurs doivent donc être à l’image de leur nouvelle société : jeunes et dynamiques… Sans augmentation de salaire.
Concernant les Points Poste, on en compte à l’heure actuelle 680 sur tout le territoire. Bpost annonce sur son site web l’atout de ce « bureau » d’un nouveau genre : « du personnel qualifié spécialement formé par bpost pour vous garantir une prestation de service irréprochable et un conseil de professionnel ». Pas plus tard qu’hier, la caissière de mon supermarché, qui doit jongler entre la « caisse rapide » et le desk postal, et qui s’excusait encore de ne pas avoir accouru assez vite à la caisse, étant retenue par une dame qui avait un recommandé à envoyer, me confiait que pour ce job de postière, elle recevait belle et bien une formation mais qu’elle aurait quand même bien aimé être payée pour cette compétence supplémentaire… Tout le bénéfice revient donc à l’enseigne de supermarché (indirectement payée par l’Etat puisqu’elle assume à sa place la mission de service universel) et pour bpost qui, d’une certaine manière, dispose d’un personnel « en noir ».
En 2014, K. Van Gerven remplace Johnny Thijs dont, grosso modo, il poursuit l’œuvre. Sur le plan financier, la situation de bpost en 2014 et 2015 est bonne. La satisfaction de la clientèle est par contre plus mitigée. La distribution du courrier souffre de nombreux couacs. Seulement 92,4% du courrier prioritaire est distribué dans les délais. Côté personnel, les politiques d’augmentation de la productivité et de diminution des coûts prévalent. La loi du 16 décembre 2015 autorise le recrutement de contractuels et le recours à la sous-traitance et aux travailleurs indépendants. Les résultats trimestriels des neufs premiers mois de l’année 2016 sont au vert et bpost clôture l’année sur un bénéfice net de 324,1 millions d’euros. En janvier 2017, la direction annonce sa décision, face à des syndicats médusés, de confier à des sous-traitants indiens une partie de ses supports informatiques.
La libéralisation totale du marché postal, intervenue en janvier 2011, aura pesé pendant des années comme une menace. Elle aura légitimé l’indispensable modernisation et privatisation de l’entreprise. Elle aura conduit les syndicats à négocier sur la défensive, dos au mur, souvent dépassés par les évènements. Quand André Blaise prend sa retraite de la direction de la CSC-Transcom en janvier 2016, il donne à la presse sa vision du futur : « L’avenir, c’est le colis et on peut demander aux facteurs de distribuer des patates, des pizzas, je serai toujours d’accord, tant que ça se fait dans de bonnes conditions de travail. Ce qui me fait peur, c’est qu’avant la fin de la législature en 2019, je suis convaincu que le capital de bpost sera majoritairement privé. Voilà le merci qu’on a obtenu du gouvernement alors que la Poste est une entreprise publique rentable, une des meilleures entreprises postales d’Europe, voire mondiale, en termes de gestion. Et on fourgue la Poste aux actionnaires privés qui seront là pour rentabiliser au maximum leur argent ».
Concluons enfin par l’introduction du Courrier hebdomadaire du CRISP. Les auteurs y signalent qu’ils préfèrent parler de mutation plutôt que de modernisation pour décrire les 25 ans de La Poste à bpost. C’est plus neutre. Parmi les lacunes citées dans leur méthodologie, ils indiquent que la plupart des sources utilisées viennent des propos tenus par les dirigeants de l’entreprise et des syndicats. Ils regrettent de ne pas avoir pu disposer de témoignages par le bas pour mieux saisir la réalité des conditions de travail. Mais ils finissent l’introduction en signalant que cette histoire-là reste à écrire.
En définitive, le Courrier du CRISP nous offre une mise en contexte de l’évolution d’une des plus grosses entreprises publiques du pays soumise, souvent à marche forcée, aux changements dûs à un marché mondialisé, et qui doit simultanément rester un service universel tel que défini par les directives européennes. Il est également frappant de constater que l’actuelle bpost a été et demeure un laboratoire commercial pour tous les nouveaux métiers émergents dans les secteurs de la distribution, de la logistique, des services bancaires mais également dans des domaines inédits. CityDepot SA par exemple qui vise à agir sur les problèmes de mobilité dans les centres-villes en créant des dépôts en périphérie. De nouvelles activités pour les facteurs comme la réalisation d’enquêtes pour des tiers comme cette enquête à Ostende dont la mission est de détecter l’isolement des personnes âgées. Ou encore CycloSafe, un service de détection des vélos volés. Toutes ces expériences "pilote" au succès relatif font de bpost une entreprise innovante constamment en prise avec les évolutions technologiques de nos sociétés. En plus de son analyse des difficultés de gestion du personnel et de communication entre les directions opérationnels et le niveau politique, le Courrier nous donne également le portrait d’un groupe mondial tentaculaire et parfois audacieux, façonné par les visions et les ambitions de ces top managers jetés, tels Icare et Dédale, dans un labyrinthe d’impossibilités.
Florence Daury
Les thématiques de l’IWEPS - L’emploi public en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles

Dans les organismes publics, les jeunes sont relativement moins nombreux que dans l’ensemble des travailleurs. Les femmes y sont surreprésentées, sauf dans les emplois les plus qualifiés. Quant à l’emploi contractuel, il demeure majoritaire, mais se stabilise alors qu’il progressait depuis 2009. La proportion de diplômés de l’enseignement supérieur au sein de l’emploi public régional est comparable à celle observée dans l’ensemble de la population active occupée wallonne. Et le temps partiel est peu pratiqué dans la fonction publique.
Admin
-
2017
novembre
-
2012
avril
-
mars
la_phrase
Le 28 mars 2012Centre d’Etudes et de Recherches en Administration PubliqueVeuillez patienter quelques secondes… -
2009
Outils typo
Le 23 mars 2009Italique : le grand chat Bold : le grand chat Orange : le grand chat Bleu : le grand chat Intertitre : le grand chat Intertitre niveau 2 : le grand chat Intertitre niveau 3 : le grand chat Indice (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
2007
décembre
test retour à la ligne
Le 16 décembre 2007Pour revenir à la ligne : la lune bonjour le soleil la lune bonjour le soleil la lune Pour afficher les petites flèches : bonjour le soleil la lune bonjour le soleil la lune test outils : bonjour (...)Veuillez patienter quelques secondes…
Documents 2
-
2011
mai
Rapport 2010 sur les concours d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration
Le 10 mai 2011Professionnaliser les jurys : concours d’entrée de l’ENA 2010 - rapport de la présidente du jury notamment sur la force d’âme des candidats Alexandre Piraux Le rapport en pdf On est toujours surpris (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
avril
Approche comparative du rapport 2010 du Médiateur de la République française et du rapport 2010 du Médiateur fédéral en Belgique
Le 20 avril 2011Florence Daury Rapport 2010 du Médiateur de la République française en pdf Rapport 2010 du Médiateur fédéral en Belgique en pdf En rendant public son rapport annuel 2010, Jean-Paul Delevoye, Médiateur (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
mars
Présentation des travaux sur l’emploi public en France et comparaison avec les autres pays de l’OCDE
Le 2 mars 2011Vincent Chriqui, Directeur général du Centre d’analyse stratégique (qui a succédé au Commissariat général du Plan en mars 2006), présente le tableau de bord de l’emploi public. Selon cette analyse, "le (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
Structure et évolution de l’emploi public belge
Le 2 mars 2011Bureau fédéral du Plan, Laurence Laloy, octobre 2010 Le secteur des administrations publiques en Belgique emploie 828 000 personnes en 2009, soit 18,7 % de l’emploi total. Les caractéristiques de (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
février
La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles. Rapport du groupe de travail
Le 20 février 2011Le rapport du groupe de travail chargé de la réforme de la législation sur les cultes et les organisations philiosophiques non confessionnelles a été remis au Ministre de la Justice en octobre 2010, a (...)Veuillez patienter quelques secondes…
Lu et vu 2
-
2011
mai
Les musées au musée ? Le patrimoine entre poussière et commerce
Politique, revue de débats, numéro 70, mai-juin 2011Le 16 mai 2011Lien vers le site de Politique Le bimestriel Politique revue de débats consacre son numéro 70 de mai-juin 2011 au thème des musées « Les musées au musée ? Le patrimoine entre poussière et commerce ». On (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
mars
Une démocratie corruptible. Arrangements, favoritisme et conflits d’intérêts
De Pierre LescoumesLe 30 mars 2011Une recension d’Alexandre Piraux Ce livre modeste par le nombre de pages mais dense quant aux analyses s’interroge sur la permanence dans nos démocraties de l’ambivalence des citoyens à l’égard des (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
Le fonctionnement de l’Union européenne
Olivier Costa et Nathalie BrackLe 11 mars 2011Extrait du quatrième de couverture Cet ouvrage a pour ambition de fournir une analyse concise de l’Union et de ses dynamiques, en accordant une attention particulière à son fonctionnement concret. (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
février
Communication publique et incertitude. Fondamentaux, mutations et perspectives
Eric Cobut et François LambotteLe 24 février 2011Quatrième de couverture Les organisations du secteur public, tout comme celles du secteur privé, sont confrontées à l’incertitude et à l’instabilité de la société. Pour relever ce défi et s’adapter au (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
2010
décembre
Dictionnaire des politiques publiques
Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot et Pauline RavinetLe 17 décembre 2010Compte-rendu d’Alexandre Piraux Le Dictionnaire des politiques publiques de Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot et Pauline Ravinet (dir.) est un ouvrage synthétique et pratique à destination des (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
novembre
Le paraétatisme. Nouveaux regards sur la décentralisation fonctionnelle en Belgique et dans les institutions européennes
Sous la direction de Pierre Jadoul, Bruno Lombaert et François TulkensLe 29 novembre 2010Compte-rendu d’Alexandre Piraux Cet ouvrage collectif publie les actes du colloque du 19 novembre 2010 sur le paraétatisme aux FUSL. Il revêt certainement un aspect très technique dans le sens de (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
Pourquoi nous n’aimons pas la démocratie
De Myriam Revault d’AllonnesLe 24 novembre 2010Une recension de Jean-Paul Nassaux La démocratie est indissociable du questionnement. Interrogation que n’ont cessé d’affronter les plus grands penseurs politiques modernes. Les questions (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
Gouverner sans gouverner
Une archéologie politique de la statistiqueLe 18 novembre 2010De Thomas Berns Quatrième de converture Nous sommes entrés dans l’âge de la transparence. L’opacité des normes a laissé la place à la limpidité des faits. Les actes de gouvernement ne réclament plus de (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
Introduction à la science politique
Objets, méthodes, résultatsLe 16 novembre 2010D’Yves Schemeil Quatrième de couverture Ce livre présente la science politique dans son ensemble. Il montre qu’elle obtient des résultats surprenants grâce à des méthodes rigoureuses. Il trouve une (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
L’argent de l’influence
Les fondations américaines et leurs réseaux européensLe 16 novembre 2010Dirigé par Ludovic Tournès Quatrième de couverture Du début du XXème siècle à la chute du mur de Berlin, les grandes fondations philantropiques américaines (Carnegie, Rockefeller, Ford, puis Soros) (...)Veuillez patienter quelques secondes…
page précédente | 1 | 2 | 3 | page suivante
Ethique 2
-
2010
novembre
Exposé introductif aux présentations de Jeroen Maesschalck et de Jean-Claude Lacroix
Alexandre PirauxLe 5 novembre 2010L’éthique publique est une notion apparemment consensuelle et apparemment neutre dans nos sociétés européennes. En réalité, elle reste une question ouverte, de par sa mise en débat permanente. La (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
La responsabilité et l’éthique dans le secteur public
Chantal HébetteLe 3 novembre 2010Qu’elle vise d’abord à construire le sens de l’action ou soit plutôt perçue comme un outil de management, la promotion de l’éthique dans le secteur public ne peut être envisagée comme une problématique (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
L’Administration générale des douanes et accises et l’éthique : l’individu au coeur du processus
Julien de Meeûs d’ArgenteuilLe 3 novembre 2010L’Administration générale des douanes et accises a développé un plan pluriannuel dont l’objectif est d’affiner le niveau de perception éthique de ses membres et, d’une façon plus particulière, de (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
Le Bureau d’éthique et de déontologie de la Ville de Charleroi
Jean-Claude LacroixLe 3 novembre 2010Le 8 décembre 2005, le Conseil Régional Wallon a voté un décret complétant l’article L 1122-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, imposant à chaque Conseil communal d’arrêter des (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
Neutralité dans les services publics : exigence éthique ou obligation juridique
Edouard DelruelleLe 3 novembre 2010En Belgique, l’Etat est neutre. Même si le principe n’est pas inscrit comme tel dans la Constitution, il se déduit d’une série d’articles, notamment les art. 19, 20 et 21. Le Conseil d’Etat a confirmé (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
Formation anti-corruption au sein de l’administration des douanes belges : impressions de campagne
Michaël DantinneLe 3 novembre 2010Cette intervention se posera en complément et/ou prolongement de celle faite, dans le même contexte, par J. de Meeus d’Argenteuil, dans la mesure où elle utilisera la même action de formation comme (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
De certaines pratiques de ressources humaines comme outils de prévention de la corruption
Eric CobutLe 3 novembre 20101. Constat La corruption est une réalité. Mais son importance varie en fonction des Etats et des types d’organisation. Même là où la corruption n’est pas problématique, le risque que celle-ci se (...)Veuillez patienter quelques secondes…
Edito
-
2016
avril

Edito
Le 11 avril 2016[ ; COPERNIC, VINGT ANS APRES ; ] Pyramides n°37/38, numéro coordonné par Marie Göransson et Alexandre Piraux, Bruxelles, 2022, 234 p. Editorial d’Eric Nachtergaele Introduction de Marie Göransson (...)Veuillez patienter quelques secondes…
Qui sommes nous ?
-
2018
novembre
Le CERAP, 25 ans déjà
Le 9 novembre 2018Le CERAP, 25 ans déjà ... Un article d’Eric NachtergaeleVeuillez patienter quelques secondes… -
2010
août

Qui sommes-nous ?
Le 30 août 2010Benoit Bayenet Le Centre d’Etudes et de Recherches en Administration Publique de l’Université Libre de Bruxelles (CERAP) est actif depuis 1992. Il a pour objectifs de former des spécialistes, de (...)Veuillez patienter quelques secondes…
Revue Pyramides
-
2012
mai
Présentation
Le 7 mai 2012Au printemps 2000, le CERAP lance la revue « Pyramides » en collaboration avec le Laboratoire de Recherches en Administration publique. L’originalité de la revue s’articule autour de deux axes : d’une (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
2009
mars
Comment s’abonner, comment commander
Le 5 mars 2009S’abonner ou commander un numéro Tous les numéros de Pyramides sont en vente au prix de 30 euros, frais de port inclus. Il vous suffit de nous envoyer votre commande par email : cerap@ulb.ac.be en (...)Veuillez patienter quelques secondes… -
2008
novembre
Devenir auteur
Le 12 novembre 2008Recommandations aux auteurs Les propositions de textes destinées à être publiées dans la revue Pyramides doivent impérativement être envoyées par fichier électronique (au format Word) à l’adresse (...)Veuillez patienter quelques secondes…
Contact
-
2012
mars
Adresse & contact
Le 30 mars 2012POUR NOUS CONTACTER CERAP - ULB Avenue Jeanne, 44 - CP 124 B 1050 Bruxelles Tél : +32 (0)2 650.42.79 Email : cerap@ulb.be Contact : Florence DauryVeuillez patienter quelques secondes… -
-
Administration - . : CERAP :. : Un site motorisé par Spip et le plugin Magusine - Thème : Cerap